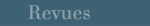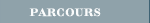Mémoire et trauma
01 novembre 2016
La Nouvelle Quinzaine Littéraire,
Mémoire et Trauma.
Connaissions-nous Charlotte Delbo ? Nous étions nombreux à avoir lu ‘Aucun de nous ne reviendra’ ou même sa trilogie ‘Auschwitz et après’. Le dernier livre de Ghislaine Dunant nous offre un énorme travail de recherche sur l’importance de cette œuvre restée largement méconnue. Il représente sept années de plongée dans l’histoire de Charlotte Delbo, celle de la Résistance, du nazisme, des camps d’extermination, celle de son retour et de son acharnement à vivre et à créer, bien souligné par le sous-titre : ‘La vie retrouvée’. Il est une rencontre entre deux femmes de lettres, entre deux belles intelligences sensibles.
« Je rencontrais une écriture qui crevait la surface protectrice de la vie pour toucher l’âme, le corps qui souffre ce qu’un être humain ne doit pas souffrir. Les mots peuvent dire ce qu’il est à peine supportable de voir, et de concevoir. Et ils peuvent ramener l’amour que Charlotte Delbo avait eu pour toutes celles, ceux qu’elle avait vu souffrir. La lucidité, la capacité de dire et d’écrire était là. Une langue pouvait rendre ce qui avait eu lieu… Elle avait cherché la beauté de la langue dans le terrible des mots ciselés en arrêtes coupantes. Elle les disait avec la douceur qui prend quand l’au-delà de la douleur est atteint. »
Une langue pouvait rendre ce qui avait eu lieu, c’est ce qu’avait réussi Ghislaine Dunant avec son roman précédent ("Un effondrement", Grasset, 2007), d’une grande subtilité.
La capacité de retrouver la vie n’est pas à la portée de tous ceux qui ont traversé l’enfer.
Quand on se projette dans la libération, le retour à la vraie vie semble aller de soi. Mais la réalité retrouvée peut paraître dérisoire à côté d’un quotidien de lutte continue pour la survie.
« L’image du serpent qui laisse sa vieille peau pour en surgir revêtu d’une peau fraîche et luisante pouvait venir à l’esprit » écrit Delbo. Or, il a fallu à tout un long et un important travail psychique pour qu’une peau neuve se reconstitue. Réapprendre à vivre au-delà des apparences avec ceux qui ne pouvaient se représenter la vie là-bas était une nouvelle épreuve qu’on n’aurait pas pu anticiper : douleur d’avoir tout partagé là-bas pour survivre et de rester, au retour, avec ce ’non-partageable en soi; l'amour qui avait fait tenir pouvait se perdre en se heurtant à l’impossibilité d’être entendu.
Comment retrouver une vie qui ne soit pas un semblant de vie ? Ceux qui pouvaient écrire, peindre, créer à leur façon, tentaient de garder contact avec le vrai, condition pour une véritable sortie d’Auschwitz.
L’accent porté par Ghislaine Dunant sur l’énergie créatrice de Charlotte Delbo renouvelle notre réflexion sur le traitement du trauma par la mémoire.
S’appuyant sur la métaphore du serpent, Delbo écrit : « La peau de la mémoire tient Auschwitz enveloppé au plus profond de soi : ‘Auschwitz est si profondément gravé dans ma mémoire que je n’en oublie aucun instant. – Alors vous vivez avec Auschwitz ? – Non, je vis à côté. Auschwitz est là, inaltérable, précis, mais enveloppé dans la peau de la mémoire, peau étanche qui l’isole de mon moi actuel. A la différence de la peau de serpent, la peau de la mémoire ne se renouvelle pas. Oh ! Qu’elle durcisse encore… Hélas ! Je crains souvent qu’elle s’amincisse, qu’elle craque, que le camp me rattrape ... »
La mémoire profonde des empreintes sensorielles et la mémoire de la pensée régie par le refoulement doivent rester séparées pour s’arracher au trauma.
« La peau dont s’enveloppe la mémoire d’Auschwitz est solide. Elle éclate pourtant, quelquefois, et restitue tout son contenu. Sur le rêve, la volonté n’a aucun pouvoir. Et dans ces rêves-là, je me revois, moi, oui, moi, telle que je sais que j’étais : tenant à peine debout, la gorge dure, le cœur dont le battement déborde la poitrine, transpercée de froid, sale, décharnée, et la souffrance est si insupportable, si exactement la souffrance endurée là-bas, que je la ressens physiquement, je la ressens dans tout mon corps qui devient un bloc de souffrance, et je sens la mort s’agripper à moi, je me sens mourir. Heureusement dans mon agonie, je crie. Le cri me réveille et je sors du cauchemar, épuisée.
Il faut des jours pour que tout rentre dans l’ordre, que tout se refourre dans la mémoire et que la peau de la mémoire se ressoude. Je redeviens moi-même, celle que vous connaissez, qui peut vous parler d’Auschwitz sans marquer ni ressentir trouble ou émotion.
Parce que, lorsque je vous parle d’Auschwitz ce n’est pas de la mémoire profonde que viennent mes paroles. Les paroles viennent de la mémoire externe, si je puis dire, la mémoire intellectuelle, la mémoire de la pensée. La mémoire profonde garde les sensations, les empreintes physiques. C’est la mémoire des sens . Car ce ne sont pas les mots qui sont gonflés de charge émotionnelle. Sinon, quelqu’un qui a été torturé par la soif pendant des semaines ne pourrait plus jamais dire ‘j’ai soif. Faisons une tasse de thé.’ Le mot aussi s’est dédoublé. Soif est redevenu d’un usage courant. Par contre si je rêve de la soif dont j’ai souffert à Birkenau, je revois celle que j’étais, hagarde, perdant la raison, titubante ; je ressens physiquement cette soif et c’est un cauchemar atroce… » .
Belle réflexion sur l’empreinte de ce qui ne peut être oublié et sur l’organisation de son récit. ‘Souder’ cette mémoire traumatique au plus profond de soi n’est pas un déni; il faut prendre garde de ne pas y être englouti, comme il fallait, là-bas, ne pas se laisser happer par la nostalgie de ce qu’on avait perdu, rester en contact avec la réalité. « La réalité était là, mortelle. Impossible de s’en abstraire ».
C’est dans le sommeil que la soudure de la peau de la mémoire peut craquer. Des cauchemars cruels, autour de la soif, il y en avait aussi à Auschwitz. Ils étaient de deux types. Celui
qui prolonge l’atroce vécu du jour : «je bois, je bois et l’eau devient immédiatement sèche et solide dans ma bouche. Et plus je bois, plus ma bouche s’emplit de feuilles pourries qui durcissent». Celui qui commence comme un rêve de tentative d’une réalisation de désir : « c’est un quartier d’orange – extraordinaire qu’on trouve des oranges ici - c’est bien un quartier d’orange, j’ai le goût de l’orange dans la bouche, le jus se répand jusque sous ma langue, touche mon palais, mes gencives, coule dans ma gorge. C’est une orange un peu acide et merveilleusement fraîche. Ce goût d’orange et la sensation du frais qui coule me réveillent. Le réveil est affreux. Pourtant la seconde où la peau de l’orange cède entre mes dents est si délicieuse que je voudrais provoquer ce rêve-là. Je le poursuis, je le force. Mais c’est de nouveau la pâte de feuilles pourries en mortier qui pétrifie.. »
Quand la nuit prolonge l’enfer du jour et même le porte au paroxysme, il faut encore lutter avec un corps étranglé, entouré de tentacules de boue qui entrent dans tous ses orifices, un corps englouti dans un fond épais, où se mêlent d’autres corps enlacés. Admirons la capacité créatrice au coeur même du cauchemar : "Il n'y a plus que la ressource de se blottir sur soi-même et essayer de susciter un cauchemar supportable, peut-être celui où on rentre à la maison, où l’on revient et où l’on dit… : c’est moi, je suis ici, je sais maintenant que c’est vrai, que je ne rêve pas, j’ai si souvent rêvé que je revenais et c’était affreux au réveil, cette fois c’est vrai, c’est vrai puisque je suis dans la cuisine, que je touche l’évier. Tu vois, maman, c’est moi, et le froid de la pierre à évier me tire du sommeil. »
Pas de dégagement possible. Ce vécu-là restera à jamais gravé dans la mémoire profonde.
Le magnifique livre de Ghislaine Dunant nous permet de saisir comment, par le travail de son écriture, "la vie fut retrouvée" par Charlotte Delbo.
Marie-Françoise Laval-Hygonenq