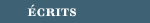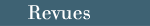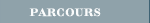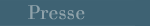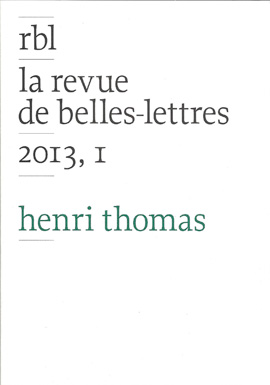Henri Thomas,
octobre 2013
La Revue de Belles-Lettres
La Revue de Belles Lettres a souhaité consacrer un numéro entier à Henri Thomas, poète et romancier, pour éclairer un écrivain qui affirme dans la deuxième moitié du XXème siècle le rôle essentiel de la poésie. Elle lui a sauvé la vie ! dit-il. Elle est la « première certitude d’un langage », c’est elle qui atteste par sa puissance d’évocation que le monde existe, et que le réel nous porte. C’est donc elle aussi qui va ouvrir de l’intérieur la forme de ses romans, de ses nouvelles. Aujourd’hui, l’oeuvre romanesque frappe par son audace, dans le ton et la forme. Sa poésie intérieure en est le moteur mis à nu.
Les étapes qui le menèrent à la poésie furent d’abord des écueils, les écueils qu’il rencontra dans son adolescence. Ne pas comprendre ce que ses premiers cours au collège lui enseignent, la torpeur et l’engourdissement qui lui font s’abstraire de cette violence – qui dira la violence de ce qui ne peut être compris ? -, le silence des adultes qui n’expliquent rien de tout ce qu’il perçoit à travers ses yeux qui clignent à l’éblouissement du monde, la noyade de son chat, le compagnon si cher, quand un déménagement se prépare dont il ne sait rien, la douleur qui le laisse muet.
Il faut laisser parler la fécondité des écueils.
La découverte du silence, de la nappe phréatique du silence, ce lieu en soi où prennent naissance les émotions, et où se fait l’attente pour trouver la langue qui les écrive. Le silence comme un sas où entrer pour distinguer quelque chose du monde, ce qu’il en apparaît. Et attendre, sans bouger. Les mots viendront.
« La plus grande aventure est de ne pas bouger,
l’hostie de glace sur la langue qui ne ment
fond, vivante fraicheur, ruisseau de mots légers. »
Lui qui fut honoré de plusieurs prix littéraires, s’efforça sans cesse de trouver la fuite dans une vie à l’écart, une vie pour écrire, vie de pénurie aussi, mais qui lui assure un véritable « délaissement », mot qu’il préférait à celui de solitude - pour la discipline qu’il veut à son travail, pour sa liberté.
« Il est un certain champ de neige dans mon esprit, où je souffre si les autres laissent la marque de leurs pas. (…) Chaque nuit de sommeil reconstitue le champ de neige ; chaque réveil voit l’assaut d’autrui aux limites, puis en plein dans le champ, et le soir le voit quelquefois entièrement sillonné et sali. (…) Mon devoir et ma joie sont de protéger cette froideur cristalline où la poésie peut seule se poser. »
A la neige qui se dépose, il faut temps et silence, pour ce qui n’a pas de poids et qui garde le mystère, y veille.
Thomas lie la poésie « à des rythmes corporels très profonds ». « A une vie aussi réelle, mais aussi inconnue de moi, que le fonctionnement de mon cœur, de mon cerveau, la façon dont sommeil et rêve interviennent ».
Le rythme semble convier l’image:
« La vague roule son bruit
jusqu’au fond de mon sommeil,
je me soulève, pareil
aux bêtes que l’on conduit
titubantes dans la nuit. »
Pour trouver l’abandon aux rythmes, Thomas marche. Il marche près de la mer, une canne faite d’une branche qui frappe le sol et donne la cadence au poème, comme il marche dans les villes, la nuit de préférence, où brumes et obscurité agencent les apparitions, conduisent à la déambulation qui se fait errance. Le poème fait alors le « moulage de l’instant ».
« Cinq fenêtres cinq étages
s’éclairent soudain,
tube, colonne de clarté,
effusion d’un cœur maudit dans l’épaisseur,
puits des mines très dangereuses
où s’aventure
lente et prudente une ombre qui tourne et suit la rampe
au cœur de l’opaque massif
où moi-même
j’ai creusé ma cellule et flairé le grisou
des nuits éruptives. »
Les titres de quelques uns de ses recueils font entendre la voix singulière de Thomas autant que l’éthique de sa création poétique : Travaux d’aveugle, Signe de vie, Le Monde absent, Nul désordre, Sous le lien du Temps, A quoi tu penses, Joueur surpris…
Gide et Paulhan furent ceux qui ouvrirent à Thomas les portes du monde littéraire, Jean Paulhan à La NRF, que ce soit la Revue, ou la maison d’édition qui publiera presque tous les livres d’Henri Thomas, et André Gide qui fait figure de mentor pour le tout jeune homme. Adolescent, il avait fait le pari depuis le lycée de lui écrire.
Ce n’est pas l’œuvre qui le liait à Gide, mais ce qu’on pourrait nommer sa discipline, comme Thomas le résume dans un hommage posthume : « Une culture ennemie de la hâte, des à-peu-près, de toute espèce de bâclage ; une volonté de rigueur esthétique et une patience dans la réalisation, par lesquelles Gide maintient la notion d’œuvre d’art reçue de Mallarmé. Un art de vivre, une façon de faire chance vertu, et de rencontre découverte. Le plus grand dispersement possible, par amour de la totalité (somme du divers jamais atteinte), et la plus grande concentration. »
Etonnamment, on peut y lire un portrait de Thomas lui-même, et dans la dernière phrase, des traits de Thomas romancier. La conscience de ne jamais atteindre la somme du divers, tout en étant aimanté par les détails qui fixent les apparitions. La volonté de suivre un fil narratif, extrêmement personnel, concentré sur cette expression d’une conscience intérieure qui se sauve par la langue. Le désir d’attraper définitivement la capacité de dire tous les mouvements de l’être, perception du monde et manifestations de soi en un seul fil narratif, et qui ne lâche pas.
« J’écris avec une espèce de tremblement très gênant : il me semble chaque fois que le fil que je suis va casser. » écrit-il à Armen Lubin. La concentration n’est pas que le mouvement de sa pensée, elle est aussi la tentative d’éviter la cassure, cassure de soi et dispersion du langage.
Si Thomas écrit des poèmes jusqu’à la fin de sa vie, comme l’atteste le beau recueil Les Maisons brûlées qui paraît après sa mort, il en écrira moins lorsque le roman s’imposera à lui pour dire la continuité dans le temps des éblouissements, et la tentative par le langage continu de la prose d’élucider ces instants. Qui n’est pas de les expliquer, mais de faire sentir la force contenue dans leur charge d’intensité, et que la langue leur donne intensité d’être.
Seize romans paraîtront chez Gallimard. Au centre de la liste, le huitième, Le Promontoire. Le plus sombre, certainement, et peut-être celui qui s’est tenu le plus près de la faille. La faille qui sépare le narrateur, traducteur et copiste (en fait, la voix d’Henri Thomas) qui passe l’hiver dans un village corse, de l’écrivain « arrivé », figure honnie et moquée, qui vient y séjourner.
« Il n’y a pas de plus petit geste que celui d’écrire », et c’est le seul auquel se tient le narrateur. Il tente d’élucider la tragédie qui s’efface, celle d’un crime survenu dans un village où plusieurs habitants sont aveugles, y compris la jeune fille qui vient le soir se baigner nue au creux des rochers, et trouver dans la nage qu’il n’est pas nécessaire de voir.
Etre aveugle rappelle l’étape féconde, ne pas saisir ce qui se passe. Entendre, regarder, assister et ne pas nécessairement comprendre. La langue, la poésie offre la riposte salvatrice : elle fait revenir dans les mots la réalité qui ne peut être saisie. Dire « la rose ! » et ainsi évoquer « l’absente de tous bouquets », Thomas aimait à rappeler ce sésame de Mallarmé. Lui, écrira :
« Venez à nous, images délivrées
Du poids mortel de la réalité,
(…)
L’arbre en personne prend congé
De lui-même et revient plus vrai. »
Pour écrire le roman, il faut être « aveugle pour tous les détails auxquels les mots correspondent si bien » qu’utilise, lui, l’écrivain « arrivé ». Il faut se détourner de ces mots-là, comme l’arbre en personne prend congé de lui-même. Leçon de la poésie.
Les mots qui correspondent trop bien empêchent de sentir « ce qui vient de plus loin, ce qui est arrivé et qui continue toujours d’arriver. »
« Je n’appartiens pas uniquement à ce cercle dans lequel ils (les habitants du village) sont enfermés sans en souffrir, - écrit le narrateur du Promontoire - mais à un autre qui ne détruit pas le premier, qui ne le contredit pas, qui ne m’en arrachera pas. J’ai conscience de ce qui nous enferme ensemble, et l’autre cercle dans lequel je suis pris c’est ces mots qui n’arrêtent pas de courir pour imiter ce qui n’est pas directement saisissable ».
Ailleurs, dans l’« Examen » qu’Henri Thomas écrit en préface de son recueil Sous le lien du temps, il précise qu’il sait peu de choses d’une histoire. « Et c’est ce peu de choses où tout se tient, c’est tout ce qui me tient, qui comptent. » Thomas enfouit les événements cruciaux. Il les enfouit dans le cours du roman, les recouvre de la fluidité des situations qui se succèdent et les dissolvent. Le romancier leur laisse un pouvoir de secret, la force du secret qu’on garde en soi.
La jeune nageuse aveugle est morte, l’événement crucial se dissout dans ce qui l’entoure, et l’encercle. « Qu’est-ce qu’il y aura eu ? Ce n’était pas un crime, ce n’était pas un suicide ; c’était la mort qui se produisait avec une telle facilité qu’en y pensant je tourne dans un espace où tout est d’accord, tout est bien mené, terminé, sans importance. »
Cette expression, « c’était la mort qui se produisait… », pourrait aussi se trouver dans John Perkins, le roman écrit l’année précédente. La mort de Jim, avec qui vivaient John et Dorothy Perkins, s’était produite, c’est tout ce qu’on sait. Le récit ne l’explique pas alors qu’elle semble à l’origine de la fêlure dans le couple. Mais tout ce qui s’est passé précédemment, se passe ou se passera après la mort de Jim, est le cercle à écrire, qui forme un récit envoûtant.
Les signes que fait la réalité, ceux que retient l’écriture des romans et des nouvelles, donnent le sentiment de pénétrer une cérémonie, dont le culte a été oublié. Il reste des vestiges que Thomas observe, ils prennent force d’énigmes et donnent la certitude d’exister parce qu’il se passe quelque chose.
Ce qui a lieu de plus saisissant, la mort ou la scène troublante, sexuelle, Thomas le place furtivement, la scène est à peine décrite. Et c’est justement l’apparition dans le trouble qu’elle suscite et sa disparition aussi rapide qui lui conservent sa puissance.
D’images érotiques de magazine entraperçues par un adolescent, ou de la jambe découverte par le vent d’une jeune fille à bicyclette, ou d’une scène à trois sur un lit vue d’une fenêtre, Thomas dit peu. Il précise juste « que le courant d’air qui agite le rideau ne dérobe pas (la scène) à la vue » pour faire entendre que les choses adviennent, surgissent. Elles ne sont ni voulues ni recherchées, – elles n’en perdent pas moins leur pouvoir de déflagration. John Perkins ne se remet pas de la scène aperçue depuis la fenêtre. « Une sorte de démence, quand la provocation jamais imaginée, surgit. » Alors il s’agit pour le romancier d’écrire comment le corps, l’esprit, la situation des uns par rapport aux autres, l’étrange ballet des actes, en sont bouleversés.
La mort qui se produit se trouve aussi au coeur de la nouvelle peut-être la plus saisissante d’Henri Thomas, « Harry » dans La Cible. La mort qui a lieu et le pouvoir fascinant qu’elle exerce sur un enfant qui collectionne les squelettes des petits animaux jusqu’à désirer lui-même devenir un squelette, dût-il mourir pour cela. Thomas garde ce fait comme une tache aveugle, personne parmi les proches n’a perçu l’ampleur de la fascination de l’enfant. Ce point vertigineux, il n’en dit pas plus, et l’effet d’effroi qu’on en reçoit à la lecture pénètre le récit qui se poursuit.
Les mots et les phrases ne sont pas là pour dégager des événements, la langue est plutôt celle qui peut rendre un état, l’engourdissement ou les intermittences de la conscience qui tâtonne, face à la puissance des émotions qui submergent. La langue fait exister.
« Je n’ai le goût de rien exprimer, si ce n’est ce noyau d’obscurité tenace qui est mon être même, ma substance morale et poétique. » écrit Henri Thomas dans Le Migrateur. Ce noyau d’obscurité est d’autant signifiant ou remarquable qu’il est la pile génératrice de force d’une écriture lumineuse, fluide, qui progresse avec douceur quoi qu’elle raconte, peut-être justement parce qu’elle cherche la lumière, la mise au jour. « Je suis tranquille quand j’écris, racontait Henri Thomas, parce que les choses mêmes ne sont pas là. Quand j’écris que ma mère sort les braises du fourneau, je sais qu’elles ne sont pas réellement à côté de moi, je ne risque pas de me brûler. » Si justement dit, ce travail de l’écriture, à l’écart du danger. Mais qui n’est pas à l’écart du risque, précise-t-il. Le risque de la fausseté, le plus grand mal qu’on puisse faire à l’écriture.
Henri Thomas romancier savait que sa renommée d’écrivain était restée plus confidentielle que celle, explosive, de ceux qu’on avait associés pour créer cette configuration du Nouveau Roman. Aujourd’hui il me semble que sa façon de s’en être résolument tenu à l’écart (il n’avait pas de mots tendres pour ces écrivains-là) est significative. Il explorait la forme narrative autour de ses « blocs d’expérience » où la voix d’un sujet « arrache une phrase après l’autre à un silence, à une sorte de stupeur », pour dire une expérience humaine brouillée, comme des voix brouillées, d’où surgissent des illuminations qui ont valeur d’infini au sein de la finitude humaine.
Ne pas éviter l’obscurité de l’être, mettre en lumière son monde flottant, ses ténèbres oublieuses. Thomas éclaire les déflagrations intérieures, et il ne les rend pas ennemies, mais amies du sujet.
« Toute pensée réussie, tout langage qui saisit, les mots auxquels ensuite on reconnaît l’écrivain, sont toujours le résultat d’un compromis entre un courant d’intelligence qui sort de lui, et une ignorance qui lui advient, une surprise, un empêchement; il faut que la parole ait frappé un objet sourd. » Il est étonnant de relire cette phrase que Jacques Rivière écrit à Antonin Artaud, le 25 mars 1924. Comme si les phrases justes n’étaient jamais perdues, et se réalisaient encore et toujours ailleurs. La langue d’Henri Thomas résonne de tout ce qu’elle a su frapper d’objets sourds dans la vie où nous sommes engourdis, et auxquels la langue qui frappe peut rendre lumière et rythme.
« Je suis tapi dans le granit
du refus total, c’est mon nid
(…)
choisissant une autre aventure
broutant le noir, ma vie obscure
a fait retraite dans la pierre
œil plein de feu sous la paupière. »
Ghislaine Dunant