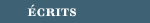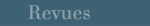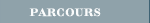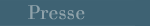Prix Michel Dentan 2008
avril 2008
Réception du Prix, le 24 avril 2008
Le prix Michel Dentan couronne deux livres cette année, un des deux est le mien, j’en suis très honorée, du prix et de la compagnie, parce que l’autre livre est une découverte pour moi et que j’aime ce tandem, un livre écrit et un livre que je lis pour le découvrir, c’est la vie même d’un écrivain.
La nouvelle du prix fut une incroyable surprise et une vraie joie.
Puis très vite, j’ai eu le sentiment qu’il y avait quelqu’un près de moi, quelqu’un qui avait reçu un prix pour un livre écrit, quelqu’un qui s’asseyait à côté de moi ou qui marchait près de mon épaule. C’était une présence rassurante, solidaire, tout de même un étrange dédoublement. C’était peut-être le moyen, très bien organisé, pour continuer, travailler, faire ce que j’avais à faire, comme si de rien n’était, tandis que l’autre irait recevoir le prix.
Bien sûr qu’il y a une séparation, une séparation naturelle comme un mouvement naturel, entre la personne qui cherche tous les jours dans l’ombre en tâtonnant à saisir quelque chose, écrire des sortes de phrases qui rendent forme et sens à ce qui est là, à ce qui se passe, à l’emmêlement de l’imaginaire et du vécu, une séparation entre cette personne-là et l’autre qui reçoit la lumière au moment de l’annonce, un écho un peu glorieux, en tous cas très heureux, venant de personnes éclairées comme on dit, qui lisent, qui cherchent elles aussi en lisant quelque chose, - et soudain cela s’était rencontré…
Une séparation naturelle, je le disais. Mais j’ai perçu autre chose dans cette image du double à côté de moi. Ce prix réveillait un autre, ou une autre en moi. J’ai deux nationalités de naissance : je suis née en France, d’une mère française, d’un père suisse. Ce n’est ni à l’un ni à l’autre que je pensai, c’est l’image de mes grands-parents qui est venue, mes grands-parents suisses qui vivaient près de Lucerne, à Emmenbrücke, c’est leur maison, ses pièces, la lumière et les ombres, les meubles et les odeurs, le jardin, les saisons, j’y suis arrivée à l’âge de cinq semaines et revenue presque toutes les vacances enfant.
Mes grands-parents parlaient le français, mais les cousins préféraient entre eux le suisse allemand ou l’italien, tous leurs camarades ne parlaient que le suisse allemand : j’arrivais à l’étranger…
Et c’est à cette langue que je ne comprenais pas, à ce déplacement Paris- Lucerne, le voyage était long à l’époque, que j’en viens. Le prix fait remonter des souvenirs, la part suisse de mon enfance, mais ce qui me frappe de manière saisissante au moment où je reçois ce prix littéraire suisse, c’est la langue que j’entendais et que je ne pouvais pas comprendre, c’est la nécessité - bien plus tard - de trouver une langue que je comprenne ou tout au moins qui fasse sens, et c’est cette image du trajet, du déplacement.
La recherche des mots, du rythme de la phrase est un déplacement.
Ce qui va de l’endroit où ça vit à l’endroit où ça s’écrit.
Puisqu’il faut partir d’une scène à saisir, opaque encore, pour arriver là où se déploie la langue qui dit, qui raconte.
Je pars d’une première image, silencieuse souvent, nimbée de brouillard ou au contraire si nette qu’elle me laisse interdite, embarrassée – par où la prendre ? De cette impression première au choix du vocabulaire, au rythme de la phrase, du paragraphe, du chapitre, il y a un long trajet.
Je chemine, avec un ton dans la tête, le ton que je veux pour le livre, j’ai l’impression de garder un diapason près de l’oreille, et cette façon de durer, tenue par quelque chose que je cherche, c’est un trajet qui me conduit d’un point à un autre. Comme tout à l’heure dans le train avant d’être là. Regarder autour de moi, voir, découvrir, dans l’attente d’arriver. Comme en écrivant. Disponible à ce qui survient d’images, de sensations, d’émotions, ce tumulte d’associations, qui dépose peu à peu, ou dans lequel je tranche à la serpe parce qu’il faut couper, élaguer, pour que circule la sève, cette fluidité du récit.
Et j’imagine comment celui-ci peut doucement entrer dans l’oreille du lecteur. Je cherche un fin conduit qui arrive là où ça peut résonner chez lui, l’ouverture de l’oreille.
« Un effondrement » raconte quelque chose que j’ai traversé il y a très longtemps. Plus j’écrivais, plus j’ai découvert que je m’éloignais du ton autobiographique, il ne s’agissait pas de raconter ce que j’avais traversé, mais de faire avec l’écriture ce déplacement, ce va-et-vient : avec la distance écrire ce que les scènes racontaient de la difficulté d’être une personne, et de très près écrire l’étrangeté de l’effondrement.
C’était mettre à l’épreuve l’écriture aussi, pour dire des choses ténues quand la vie semble s’arrêter et que la réalité s’éloigne, et que quelque chose de la langue reste, comme de la vie fluide encore. Et une voix douce parlerait pour dire la distance et l’étrangeté.
Que ce soit ce livre que j’ai tenté d’écrire, que vous couronnez, est un cadeau, qu’il se trouve associé à un autre livre - qui m’intéresse profondément - est un signe auquel je suis très sensible. Je remercie très chaleureusement le jury de l’honneur que je reçois, de la joie que j’éprouve.
La surprise, qui a tout le temps lieu dans l’écriture celle de trouver enfin le mot, la surprise reste et m’enchante.
Ghislaine Dunant