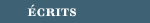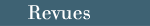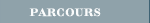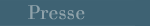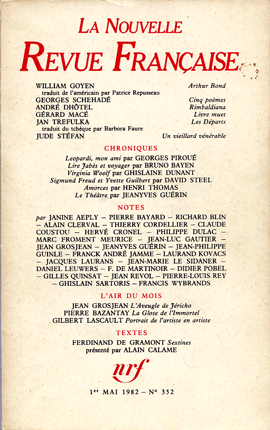Virginia Woolf: un credo romanesque
mai 1982, Chronique
Gallimard, NRF n°352
Virginia Woolf est méconnue. Quand son nom circule, chacun professe de l'estime. Bien peu seraient à même de l'étayer. L'oeuvre semble souvent enveloppée d'un épais brouillard. Mais des images de Virginia circulent. Elles ne sont pas fausses. Une femme de la "haute société", snob, égoïste et terriblement intellectuelle, drôle, sans indulgence.
Et qui a trempé dans la folie. Son suicide est aujourd'hui un cliché. Sa silhouette s'enfonçant dans l'Ouse un jour de printemps 1941, laissant derrière elle sa canne plantée sur la berge, sert de raccourci à quarante ans de lutte avec l'écriture.
Un ersatz à l'oeuvre elle-même.
Tout à la fois il est habituel de la citer avec les fondateurs de notre littérature du XX ème siècle. Aux côtés de Kafka, Joyce, Proust, Faulkner. Seule femme, elle est aussi - ou conséquemment! -, de loin, la plus mal connue. Comme exilée de bien des consciences de lecteurs avertis.
Aujourd'hui paraît en français son Journal. Bientôt sa Correspondance sera accessible. Ces éditions doivent profiter à la lecture ou à la relecture des romans. Cette actualité doit permettre d'ouvrir un débat sur cette oeuvre jusque-là trop "gardée" - comme il y a des chasses gardées -, trop réservée à quelques connaisseurs. Son enjeu aujourd'hui, par rapport ˆ l'époque des parutions, s'avère essentiel. D'autant plus que depuis dix ans cohabitent les tendances et les mouvements les plus divers et que, face à cette production, nous pouvons considérer les romans woolfiens comme un ensemble, d'une part totalement éclaté dans la diversité, d'autre part le plus personnel qui soit dans la subversion des techniques romanesques traditionnelles. Des atouts qui font de la lecture de ces romans une lecture exemplaire.
Terme employé d'autant plus facilement que l'oeuvre de Woolf n'a pas eu de postérité jusqu'ici (une voie qui a été sentie comme trop particulière) et qu'elle n'est pas un exemple à la lettre (justement à cause de cette voie si personnelle), mais qu'elle est un exemple par l'esprit, par la vision qu'elle offre. Vision du roman, vision de l'écriture, vision de la réalité. Visions d'un écrivain qui a consacré quarante ans de sa vie à la littérature. Sans répit. Quand elle n'était pas au travail, c'est sa maladie qui l'en écartait; elle était "en folie", absente à l'écriture. "Peu d'auteurs ont été aussi torturés que moi par le métier d'écrire; Flaubert excepté" (Journal, 23 juin 1936). Ce n'est pas sa souffrance qui justifie son oeuvre. Mais c'est le prix dont elle a payé ses oeuvres.
A la lire, à la relire, un sujet parmi tous ceux qui font son oeuvre, domine : l'écriture. Woolf s'interroge. Que peut-on écrire ? Comment l'écriture peut-elle rendre compte de l'expérience qu'on a du monde? Comment peut-elle transformer cette expérience? Interrogations qui en sous-entendent une autre : qu'est-ce que l'écriture?
Tous ses romans relèvent d'un récit passionné du monde. Un monde pris aux rets de l'écriture. Les Vagues illustrent parfaitement ce credo. Le roman aurait pu avoir 6.000 pages ou plus, puisque le monde est infini et que Woolf est certaine que l'écriture tient aussi son pouvoir de son caractère infini. Et c'est peut-être parce que ce roman a inévitablement une fin, un terme, que l'auteur donne à certains lecteurs le sentiment d'un échec. La réussite du livre est bien de tout vouloir dire de l'expérience du monde et de confier à l'écriture cette tâche, cette fonction; la réussite c'est d'avoir mis l'écriture à cette épreuve. L'échec est dans la nécessité du roman, la nécessité d'une fin qui clôt l'ouvrage pour une raison de forme, extérieure au propos du livre. Mais Woolf avec Les Vagues, malgré la condition nécessaire de cet échec, portait plus loin l'ambition poétique du roman que ne le faisaient à la même époque Joyce et Proust. Et il est des échecs plus féconds dans leur ambition, la vision qu'ils proposent, que certaines réussites.
Woolf est de ces écrivains pour qui le roman est "le grand genre". D'abord en le comparant à la poésie, elle lui accorde plus de qualités. Elle trouve la prose seule capable de véhiculer la beauté"; elle la juge plus libre, plus complexe dans ses moyens d'évocation. Ensuite, à ses yeux, le roman peut le mieux se débarrasser de ses techniques traditionnelles, peut se bouleverser, donc s'inventer. Enfin c'est le genre littéraire le mieux à même de rendre compte du travail de l'écriture. Et ce sont ces possibilités-là du roman qui font, qu'au moment de projeter ses oeuvres, elle peut se poser d'abord la question de leur forme, de leur écriture, et en dégager peu à peu seulement, le sujet. Sujet qui ne naît vraiment que quand Woolf en a élaboré la forme.
Son Journal témoigne de ces étapes pour chacun des romans. Citons, par exemple, le projet de La Chambre de Jacob (1922), premier roman novateur de Woolf : "Je suis beaucoup plus heureuse aujourd'hui que je ne l'étais hier, étant parvenue à quelque idée d'une nouvelle forme pour un prochain roman. Supposons qu'une chose découle d'une autre - comme dans un roman non écrit - pas seulement sur 10 pages, mais sur 200 ou plus - cela ne donne-t-il pas le jeu et la légèreté que je désire? Cela ne devient-il pas plus resserré tout en gardant ses contours et son mouvement? Et cela n'englobe-t-il pas tout, oui, tout? (...) Car j'imagine que l'approche sera entièrement différente cette fois : pas d'échafaudage; à peine de briques visibles; tout crépusculaire, mais le coeur, la passion, l'humour, tout cela aussi brillant que le feu dans la brume. (...) II me reste à découvrir ce qui fera l'unité; le thème m'est encore inconnu ; mais je vois d'immenses possibilités dans la forme que j'ai trouvée plus ou moins par hasard il y a deux semaines." C'est le pouvoir générateur de l'écriture qui l'intéresse, la fait écrire. C'est là la nécessité et la spécificité de son écriture romanesque.
Et il est évident qu'à partir du moment où l'écrivain cherche à percevoir avant tout une forme, se demande d'abord comment dire, une fois que se dégage cette forme, naît un désir de dire le plus possible avec cette forme nouvelle. Dire tout, parler de tout. Multiplier les thèmes ou les sujets apparents pour mettre à l'épreuve cette écriture, ce ton, cette vision et du même coup lui donner sa force, ses pleins pouvoirs. Il y a aussi cette volonté de tout dire chez Joyce, Musil, Proust. Dans La Chambre de Jacob, Woolf dit tout ce qui est autour de Jacob aux lieu et place de Jacob lui-même. Ceux qui voient Jacob, ce qu'il voit et fait, ce qu'il aime et ceux qui l'aiment. Sujets infinis, si ce n'est que clore est indispensable, puisque c'est de finir cette esquisse des "pourtours" de Jacob qui livre "en creux" son portrait, et le sujet du livre.
Tout dire, c'est ce que nous exigeons aussi dans ce siècle où aucun sujet n'a plus la priorité. Si tous les systèmes de valeurs se sont effondrés, il faut en corollaire parler de tout, puisque les priorités ont disparu. Et on a bien, à lire les romans de Woolf, l'impression d'un monde aux valeurs indistinctes - sans doute aussi parce que la description du monde est remplacée par l'expérience que les personnages en font. Expériences tous azimuts, d'êtres qui se racontent, qui racontent d'eux des fragments de leur vie en train de leur échapper. A la manière d'Isa, dans Entre les Actes : "Des pièces, des morceaux, des fragments", c'est la seule citation qu’elle se rappelle de la pièce en train de lui échapper. A la réalité objective, Virginia Woolf substitue "l'effet des choses sur l’esprit", "les myriades d'impressions banales, fantastiques, évanescentes ou gravées avec l'acuité de l'acier" qui frappent chaque être et leur donnent cette réalité que Virginia retient d'eux. Le récit suivi apparaîtrait alors comme simplificateur puisqu'il oblige par son développement linéaire à disposer les faits ou les effets selon l'ordre de la succession. Or il n'y a pas de recherche d'ordre chez Virginia, mais une recherche de densité. "L'idée m'est venue que ce que je veux maintenant, c'est saturer chaque atome. Je vise à élminer toute perte, toute chose morte et superflue; à donner le moment tout entier, avec tout ce qu'il peut inclure. Disons que le moment est une combinaison de pensée; de sensation- la voix de la mer... Les poètes réussissent en simplifiant: pratiquement tout est laissé en dehors. Moi, je veux tout y mettre : et cependant saturer. Il doit y avoir de l’absurdité, des faits, du sordide : mais rendus transparents" ( Journal, 28 novembre 1928).
La gestation des Vagues a été la plus longue, la plus difficile. Parce que ce roman avait le projet de faire aboutir toutes les recherches précédentes. Woolf a cherché quatre années la conception d'une oeuvre qui est une expérience, nous pourrions dire une expérience limite, de l'écriture.
La réalité que restitue Woolf est sans ordre. C'est la réalité des impressions reçues. L'image ainsi donnée du monde est éclatée en multiples fragments. Les êtres, identifiés à leurs impressions, sont chacun un fragment de cette réalité. Il y a un sentiment tragique du discontinu que cherche à rendre Woolf. Discontinu entre les myriades d'impressions reçues, discontinu entre les êtres. Discontinu qui fonctionne aussi comme un révélateur: puisque tous les êtres sont séparés, isolés, ils ont même valeur. Puisque les faits, les actes importent par l'impression qu'ils donnent, ils sont à priori tous dignes d'intérêt et sur le même plan. II y a là chez Woolf une façon foncièrement nouvelle de "cadrer" un sujet. Sans premier plan, sans fond du tableau. Mais en employant toujours le même filtre : celui qui révèle la densité de l'instant.
Entre les êtres et la réalité objective qu'ils vivent, Woolf établit aussi une discontinuité. Celle qui sépare leurs aspirations, leurs désirs, de la vie réelle. La solitude et l'angoisse viennent de cette discontinuité. Traverser les apparences, c'est découvrir l'inadaptation des êtres au monde. Cette fêlure est la même que celle qui existe entre raison et folie. Clarissa Dalloway et Septimus Warren Smith, l'homme rendu fou par la violence de la guerre, sont la double face d'un même être. Le roman avance pour faire coïncider leurs destinées, pour forcer le parallèle, pour montrer que la raison n'est pas loin de la folie, que l'une est à côté de l'autre. Pour révéler cette contiguïté - qui est une forme de la discontinuité -, Virginia Woolf rapproche, juxtapose les différences. Ayant placé tous les faits, les êtres sur le même plan, ces différences apparaissent comme des ruptures, brusques, violentes, qui font le mouvement de son écriture.
Si ces ruptures frappent le lecteur, c'est qu'elles ont dans le texte leur contrepoint. Dans tous les romans s'entend un appel à l'unité, à une identification entre les êtres et la réalité. D'ailleurs la densité de l'instant, cette saturation, à laquelle Woolf veut parvenir dans son écriture, traduit bien sa volonté de restituer à la réalité son unité. Réalité si pleine, si unie que les êtres eux-mêmes se sentent faire partie d'un tout. Et la confession de Bernard dans Les Vagues pourrait être celle de tous les personnages de Woolf : "Je ne crois pas à la valeur des existences séparées. Tout seuls nous sommes incomplets ; nous sommes faits pour être unis."
Ce désir lancinant de l'unité se révèle aussi à travers toutes les images sphériques dont l'écriture abonde. Que de "cercles", de "centres", de "roues", qui unissent la discordance! "Tous les bruits s'unissent dans le bruit d'une
seule roue qui tourne. Chaque son particulier, les coups de sifflet, les cloches, les cris des ivrognes et des passants engaieté façonnent un seul son comme un cercle d'acier bleu (Les Vagues). Et il suffit de rappeler le leitmotiv qui symbolise la présence et l'unité soudain réelles de Londres dans Mrs Dalloway, pour comprendre la valeur de l'image : "Les cercles de plomb se dissolvent dans l'air", quand sonne Big Ben.
On peut rapprocher de ces images circulaires ce que Woolf dit elle-même de son travail sur les personnages. "Je creuse de belles grottes derrière mes personnages. Je crois que cela donne exactement ce que je désire : humanité, humour, profondeur." Ces "grottes" des personnages ressemblent à leur chambre intérieure, une "chambre à soi" où se travaille leur épaisseur romanesque. Chambres de gestation, ces "grottes" sont les matrices des personnages.
Le thème et l'image de la chambre reviennent fréquemment dans l'oeuvre. La chambre est un lieu d'unité. Non pas au sein du monde, mais en dehors du monde, en marge. Lieu où l'être concentre son énergie pour réconcilier les contraires. La chambre est un lieu de création, un espace qui donne identité et profondeur. Quand Septimus Warren Smith (dans Mrs Dalloway) se jette par la fenêtre, dans un acte de démence, semble-t-il, il s'enfuit en fait de sa chambre, pour éviter la violation de son espace, le viol de son identité. Le psychiatre qui monte l'escalier va forcer sa porte. Se précipiter dans le vide, c'est chercher dans la mort un autre espace. Un autre espace pour faire son unité. "La mort est un effort pour s'unir", pense Clarissa Dalloway. Mort et vie ont un étrange rapport de contiguïté dans l'oeuvre de Woolf. Comme si elles n'étaient pas plus différentes que toutes ces impressions -juxtaposées- qui viennent frapper l'être avec leur discontinuité violente.
Et Woolf a construit ses romans a partir de ces fragments. C'est leur juxtaposition qui forme l'identité discontinue des personnages. "Ni intrigue ni comédie ni tragédie ni histoire d'amour ni catastrophe au sens convenu de ces mots" ne se retrouvent, dit-elle, dans ses romans. A la trame traditionnelle d'un roman, à cette charpente aisément repérable, Woolf a substitué un éparpillement des sujets en autant de "moments de l'être" distincts, instants faits d'impressions où l'être-personnage-de-roman se reconnaît. A ces myriades d'impressions se mêlent les instants que l'écrivain lui-même saisit en contrepoint du récit. Plusieurs voix parlent. Dans aucun de ses romans il n'y a un seul point de vue. Il s'en trouve autant que de personnages, auxquels s'ajoute celui de la romancière, qui fait ainsi de son écriture un constant déplacement aussi mouvant que la réalité décrite.
Il y a un étonnant mouvement dans l'oeuvre de Woolf.
Evidemment et surtout le mouvement de l'eau, dont l'imaginaire woolfien est imprégné -parfois jusqu'à l'obsession-, mais aussi le mouvement qui vient des constantes ruptures entre les impressions successives. Woolf est le premier écrivain à travailler ses constructions romanesques selon des critères de mouvement : mouvements différents, alternances, qu'elle développe irrégulièrement. Construction qui devient le sujet même des romans. A propos des Vagues en train de s'organiser lentement, Woolf note : "Je n'essaye pas de raconter une histoire. Cependant ce pourrait être fait de cette manière. Un esprit en train de penser. Ce pourrait être des îlots de lumière - îlots dans le courant que j'essaye de représenter ; la vie elle-même qui s'écoule. Le vol des éphémères puissamment attirés en ce sens. Une lampe et un pot de fleurs au centre. La fleur peut toujours changer. Mais il doit y avoir plus d'unité entre chaque scène que je n'en peux trouver pour l'instant." Des impressions et des images précises naissent dès le début du projet. La construction de l'ensemble s'ébauche par mouvements (la lumière semble elle-même un mouvement) et fournit peu à peu le sujet. L'ouvrage prend sa forme au fur et à mesure que les images, les impressions s'additionnent et prennent leur force, à la limite leur autonomie.
Un seul roman échappe à cette structure et possède dès le départ une unité du sujet et un seul point de vue : c'est Orlando. Exception qui provient du contenu : il s'agit du récit d'un être qui possède la condition des deux sexes et qui parcourt quatre siècles. Le caractère androgyne du personnage donne la clé de la construction puisque son pouvoir symbolique est d'unir les contraires, de contenir réunies toutes les oppositions. En tant qu'union dynamique, l'androgyne devient le sujet par excellence, qui investit naturellement tout l'espace du récit.
Virginia Woolf ne fait pas de l'écriture un moyen pour comprendre le monde. Son écriture n'explique pas le monde. Elle entretiendrait plutôt avec lui un rapport de contiguïté. Placé à côté de la réalité, l'écrit contient autant de problèmes et ne résout aucun de ceux du monde. Dans l'utilisation qu'elle fait des images, Woolf nous le dit encore : par exemple, à l'inverse de Proust, elle ne les explique jamais. Ses images se présentent plutôt comme des visions, des hallucinations. Woolf ne les amène pas comme si elles s'imposaient pour achever d'exprimer sa pensée, ni n'en déduit expressément un sens. Comme si les images elles aussi reflétaient la discontinuité tragique des choses entre elles, des êtres entre eux.
Woolf cherche, comme prise par un mouvement de vertige, à mettre son écriture à l'épreuve : restituer l'effet des choses sur l'esprit au moyen d'images "à l'état brut". C'est ce procédé qui fait de son écriture romanesque une écriture poétique. Avec ces myriades d'images elle met à l'épreuve la cohérence de son récit, son unité, sa valeur d'expression, de vérité - rappelant là ce rôle de l'écriture poétique d'interroger sa propre capacité d'expression. Les ruptures entre ses images, les surprises qu'elles suscitent, leur caractère incongru parfois puisqu'elles ne sont jamais justifiées, font de ses romans une écriture limite. La cohérence des images ne se fait que dans la sensibilité, l'imaginaire du lecteur; elles l'obligent, pour être reçues, à une émotion, une disponibilité extrêmes, à être prêt à se laisser chavirer. Comme la prose de Woolf est souvent à la limite de chavirer au-delà du sens, là où le texte traduirait tout ou rien. Frontière jamais atteinte. Pourtant Woolf construit, au fil de ses oeuvres, une écriture, qui s'affirme dans Les Vagues et Entre les Actes, où les images comme des myriades de fragments poétiques scandent le texte, seuls, pour eux-mêmes, en liberté. C'est-à-dire sans cheminement, sans explication. En ce sens, elle est l'anti-Proust. L'opposition ne s'arrête pas là. II n'y a pas non plus chez Woolf de composition, de "cathédrale" qui unit ses volumes. Ce n'est pas dans une composition d'ensemble que l'oeuvre trouve son sens, ou recherche son unité, mais dans cette expérience inlassable d'écrire ce qui paraît impossible à écrire. Le credo de Woolf conjure l'impossible. "Un roman, pour être bon, doit sembler, avant qu'on ne l'écrive, quelque chose d'impossible à écrire, uniquement quelque chose de visuel" (Lettre à Vita Sackville-West du 8 septembre 1928). Le sujet de l'écriture est toujours autre part qu'on le croit. Comme la réalité du monde dépasse l'individu, est ailleurs qu'il ne la sent d'abord. "Ce n'est pas avec soi-même que l'on reste, mais avec quelque chose dans l'univers. C'est cela, quel que soit le nom qu'on lui donne, qui demeure effrayant et stimulant. On aperçoit une nageoire qui passe au loin" (Journal, le 30 septembre 1926). L'oeuvre romanesque de Woolf tient place pour nous aujourd'hui d'interrogation exemplaire. Elle a attribué au roman la tâche d'interroger l'écriture. Elle a fait de "l'écriture à l'épreuve" le sujet romanesque. Et du roman, une épreuve de l'écriture.