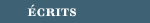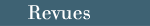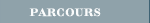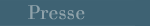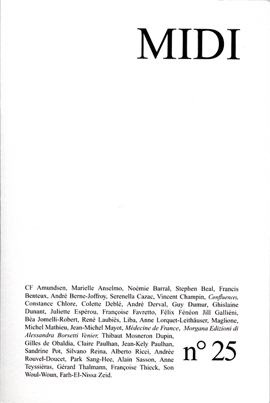L'Oiseau
juin 2007, nouvelle
Midi n°25
Les nuages s’amoncelaient mais il y avait encore un peu de ciel bleu. Je me demandai s’il n’allait pas pleuvoir. Je n’avais pas beaucoup de temps pour cette promenade, mais je voulais encore ce soir marcher sur le chemin qui ressemble au lit d’un torrent, descend au milieu de vignes aussi hautes que moi, bifurque avant d’arriver à la rivière et remonte la colline. C’était magique de marcher entre les rangées de vignes aussi épanouies qu’une forêt tropicale, d’entendre le bruit de la rivière cachée derrière les arbres et de revenir à flanc de coteaux, sous les vignes, pour arriver loin après la sortie du village. Je débouchais sur la grand-route, je rentrais d’un voyage.
J’étais partie tard, je n’avais qu’une heure, il fallait marcher vite.
Je devais faire attention à ne pas glisser, heurter un de ces cailloux qui sortent de terre et ne demandent presque rien pour se détacher, rouler sous ma semelle et m’emporter en bas de la pente. Je m’étonnais, comment réussissent-ils à travailler la vigne sur une telle pente ?
La dernière fois que j’étais passée, j’avais découvert un drôle d’engin, je l’avais pris pour un jouet d’enfant qu’on avait oublié là, caché par le feuillage au pied d’une vigne. Je me suis approchée, ce n’était pas un jouet, il était fait de pièces solides, d’une roue à rayons, d’un siège et d’une tige en fer à raccrocher à un autre élément. Il devait servir à travailler la vigne, assis en se glissant entre deux rangées. Travail minutieux, patient, à exécuter à hauteur de mains. Une preuve, encore une preuve de ce qui m’impressionne quand je longe les rangées, la richesse de la vigne, et sa superbe. Elle se dresse, débordante de vie et maîtrisée, magnifique et parfaitement alignée, sans une feuille abîmée. Le vin de la région est cher, le travail à la mesure.
Je me dépêchai. J’avais voulu venir jusque-là , je ne pouvais pas m’attarder. Il fallait juste que, dans ma précipitation, je ne me torde pas la cheville. Après le virage, ce n’est pas comme d’habitude. Il y a un oiseau par terre. Un oiseau gris argent, les ailes ouvertes, emmêlées dans le filet qu’il a tiré jusqu’au sol.
Depuis quelques jours, un filet a été déployé pour empêcher les oiseaux de becqueter les grains mûrs. Je le voyais comme un signe, le raisin arrive à maturité, mais je découvre un piège redoutable. L’oiseau ne bouge plus.
Il est beau, le bec jaune, le tour de l’œil jaune, du bleu dans les plumes grises, il est gros, je n’en ai pas vu de si gros dans cette campagne, excepté là -bas où les choucas volent au-dessus des champs.
Soudain un soubresaut, l’aile bat le sol, il vit ! Il vit encore !
Il faut que je le tire de là. Je ne sais comment faire. J’ai une seconde d’hésitation, je dois toucher l’oiseau, les plumes. J’ai un mouvement de recul, je ne sais pas ce qui se passe. J’ai peur de l’animal. L’oiseau m’effraie. J’ai peur de toucher ses plumes, lui, l’habitant de l’air et moi, terrienne. Je n’ose pas le prendre dans mes mains comme si je n’avais pas le droit d’établir cette continuité et que je doive rester séparée.
Mais sa vie ? Je veux sauver sa vie, essayer de sauver la vie à l’intérieur de l’oiseau. Tout à coup je ne vois que la vie, vibrante et vulnérable, et qui m’est indispensable. Si je ne fais pas tout ce que je peux pour sauver l’oiseau, c’est moi qui suis menacée. Je soulève ses ailes, je cherche sous les plumes le filet, je tire, mais je serre les fils qui se sont glissés autour du cou et du ventre. Je l’étrangle. Les mailles le retiennent jusqu’à l’étouffer. Comme à chaque mouvement d’aile qu’il a dû tenter pour s’échapper. Chaque coup d’aile ou ébauche de coup d’aile l’a étranglé un peu plus. Depuis combien de temps ? Depuis combien d’heures ?
Alors je déchire. Je déchire le filet, ça fait mal dans le pli de la main, c’est du nylon, c’est solide, j’arrache les nœuds des mailles, je m’accroupis pour m’arc-bouter, je tire avec les bras et les poignets. Je déchire le filet qui le fait mourir, je fiche en l’air le travail de ceux qui protègent leur vigne, je veux que l’oiseau vive. Parce qu’il y a une toute petite chance que l’oiseau vive.
L’œil est rond, la tête posée au sol, le bec fermé. Ses pattes sont inertes, pattes et griffes emmêlées dans le filet. Je soulève une patte pour tirer sur les fils, la patte est molle. Il ne bouge pas. Le bel oiseau est sur la terre, les ailes ouvertes, tombé sur ce chemin qui ne mène plus nulle part pour lui.
Et tout à coup, les ailes se replient, un seul mouvement prend tout son corps et il s’envole. J’ai à peine entendu un bruit léger, un froissement. Il est déjà à deux mètres au-dessus du sol. Son vol faiblit ! J’ai cru qu’il pourrait voler, mais il est trop faible, il va tomber. Il remonte ! Il vole haut, très haut. Et je ressens un immense bonheur. Il plane haut au-dessus des arbres, il pique vers la rivière entre les arbres. L’eau ! Il descend vers l’eau après la bataille, après la lutte sur le chemin dans la chaleur. Je le perds de vue derrière le rideau d’arbres. Je garde les yeux vers le ciel. Je me sens infiniment légère.
Je n’ai envie de rien d’autre. Je dis alors une phrase pour moi, à l’intérieur, j’ai délivré mon âme, c’est ça, j’ai délivré mon âme.
Avant de me remettre à marcher, je regarde autour de mes pieds et derrière moi, le filet tiré par l’oiseau fait une longue traînée sur le sol. J’entends encore son envol, le léger froissement, son corps qui s’échappe du sol. Plus rien ne sera comme avant dans ma vie, je le vois comme une étrange évidence.
L’oiseau prisonnier en fin de journée, qui serait passé là encore ce soir ? L’oiseau m’a appris que c’était simple de lui redonner son envol.
L’animal était silencieux sur le sol. Il y avait quelque chose de si digne dans son silence. Ou c’était le moment qui était grave et débordait sur le silence, parce que l’oiseau allait mourir.
Le silence de l’oiseau, le silence de l’oiseau au bout de mes doigts, c’est quelque chose que je voulais. Le silence de l’oiseau qui vit, qui survit, qui attend. Son silence d’animal, silence de sa gorge, de tout son corps. En faisant tout ce que je pouvais pour qu’il vive, pour que ça ne s’arrête pas, que vivent l’oiseau et le silence qui était le sien à ce moment-là, je faisais tout pour avoir ce silence. L’avoir pour moi. Avoir ce silence et vivre. Je voulais cette continuité entre l’oiseau et moi.
Cette histoire s’est passée il y a presque une année. Plusieurs fois j’ai commencé à l’écrire et plusieurs fois je m’arrêtai. Après deux ou trois pages, j’avais presque tout raconté du moment où j’ai vu l’oiseau à peu près mort et de mon besoin de le laisser échapper. Mais il y avait des tas d’autres faits qui se glissaient dans le récit, tellement de choses de ma vie semblaient se mêler à cet événement, je n’arrivais pas à stopper le fleuve qui grossissait et j’avais l’impression de laisser glisser ce qui avait fait ce moment et pourquoi je le gardais.
Je revoyais le séjour entier dans la maison en haut des vignes, les trois semaines qui avaient précédé cette heure-là , la conversation avec Suzanne l’après-midi sur la terrasse avant de partir marcher justement pour l’oublier. Le récit n’arrêtait pas de grossir et d’ensevelir l’oiseau, son envol et le bonheur qu’il m’a donné. Or c’était une histoire simple, avec des contours précis, je voulais l’écrire pour la garder.
Et cette nuit, j’ai vu en rêve un autre animal, un cheval, bien différent de mon oiseau. En me réveillant je n’ai pas voulu quitter l’animal, je le faisais passer et repasser dans ma tête, parce que j’aime me tenir près d’un animal. J’observe souvent le chat dans la maison quand il se tient assis et qu’il me regarde, quand il s’allonge et qu’il prend la pose. Ces animaux, de ma vie ou du rêve, ont en commun le silence, le silence dans lequel j’entre quand je les regarde, le silence qui m’amène tout près de la vie et de l’inattendu qui a lieu à chaque seconde parce qu’il y a la vie.
Avec ce silence en tête ce matin, ce désir de silence pour plonger dans la vie, j’ai pensé que je pourrais écrire l’histoire de l’oiseau.
Aussi parce que ce silence m’a paru l’exact opposé des mots blessants que j’avais entendus la veille, des mots jetés avec violence qui blessent comme des couteaux. Je plongerai dans le silence comme pour chercher quelque chose au fond de l’eau, la possibilité dans le silence de sentir le temps.
Je me souviens, le soir de ma rencontre avec l’oiseau, quand j’ai pu regarder le livre sur les oiseaux d’Europe, j’ai découvert que j’avais rencontré un coucou, le coucou gris. L’oiseau le plus sonore de mon enfance !
J’entends encore résonner dans mon oreille « cou-cou, cou-cou », ce cou-cou espiègle d’un oiseau que je n’ai jamais réussi à voir.
C’était un appel, toujours le même, je croyais qu’il s’adressait à moi, je n’étais pas sûre, j’en ai douté, puis j’ai accepté qu’il n’était pas pour moi ni pour quelqu’un d’autre, mais je n’en étais pas vraiment sûre non plus, je savais juste que son destin ou le mien, c’était que je ne voie jamais le coucou, ne le rencontre jamais, et entende toujours son appel dans le vide, puisque je ne savais pas le voir.


Ptica, traduction en slovène de Verna Kondric Horvat
2013
Gluscht, Anthologie de littérature suisse contemporaine , Drustvo slovenskih pisateljev, Ljubljana