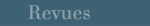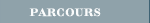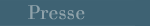n°4 - Il manque beaucoup
Sous la nef du Grand Palais, Christian Boltanski installe sur l’immense surface du sol des vêtements récupérés. Ils sont alignés presque à perte de vue en carrés, des luminaires en néon sont suspendus à des traverses verticales, il me semble voir l’image des baraquements, quelque chose de l’organisation industrielle de l’extermination. Au centre, une montagne de vêtements. Une grue soulève au sommet quelques vêtements qu’elle laisse retomber. Des battements de cœur résonnent.
De l’oeuvre de Christian Boltanski au Grand Palais, la presse, la télévision, la radio par ce qu’elle en raconte, nous inondent d’images, de descriptions, d’entretiens pour inciter à aller la voir, à la trouver «remarquable», «exceptionnelle». Je n’ai pour le moment lu ou entendu aucune réserve.
Il manque quelque chose, il manque beaucoup, à cette œuvre puisque Boltanski a voulu que l’exposition fasse œuvre. La part des objets est si importante, monstrueuse par sa dimension spatiale, qu’elle semble vouloir s’installer seule justement et obstruer tout sens à donner de la part de l’artiste, tout sens à recevoir pour le spectateur.
Or des objets à voir, ce furent déjà des montagnes de vêtements, des montagnes d’effets quotidiens qu’on voyait sur les photos, et qui remplaçaient les cadavres et faisaient un blanc sur le crime, sur la représentation du Mal, sur la signification du Mal.
Les images d’Auschwitz ont fait effroi parce qu’elles montrent l’impensable. Les dupliquer, ou du moins s’appuyer sur ce qu’elles ont laissé dans nos mémoires comme trace inamovible - inamovible parce qu’elles ne peuvent bouger, signifier en nous -, reproduit le même effroi.
D’une œuvre, j’attends qu’elle me propose une appropriation d’un sens singulier, ou une expression d’émotions singulières qui me permettent d’exister comme individu pensant et humain.
J’éprouve un profond malaise à être en face de tous ces objets, qui font référence à ce qui est ma mémoire, ce qui est dans nos mémoires, sans que je reçoive une pensée, une émotion qui nourrissent les miennes.
Christian Boltanski a toujours dit qu’il travaillait hanté par la Shoah, pour des raisons autobiographiques dont il s’est expliqué, je pourrais ajouter pour des raisons qui nous concernent tous.
Il ajoute qu’à travers cette oeuvre, c’est à la mort, à notre condition de mortel, au hasard des destins qu’il peut faire allusion, à la mort et à la vie avec les battements de cœur. Que ces vêtements peuvent aussi ramener à la catastrophe récente de Haïti ou aux images du tsunami de 2004. Cet éparpillement de références me laisse dubitative, je ne vois pas de rapprochement entre ces images de catastrophes naturelles et un alignement de vêtements ni une montagne de vêtements.
Christian Boltanski dit qu’il a voulu le froid, et il a déplacé la date de l’exposition pour se servir de la météo d’hiver. Le froid devient un concept d’exposition. Ce froid qui servait aux nazis à décimer dans les camps pendant les appels interminables, ou ce froid utilisé à la Kolyma comme le raconte Chalamov. C’est dans le permafrost qu’étaient creusés les cachots.
Je vois encore là une duplication du réel pour faire œuvre, et une duplication qui évacue une possibilité d’élaborer un sens et me ramène à l’effroi devant un réel impensable, que je ne peux m’approprier et qui me fige.
Je me sens prise en otage devant cette duplication.
C’est comme si j’y participais, moi aussi. Que j’entrais moi aussi comme un objet dans cette duplication. Il me vide de tout sens, me fait miroir d’un réel dont en plus l’horreur dans l’Histoire semble être gommée.
Ghislaine Dunant
Le texte de cette Lettre a été publié sur le Monde.fr samedi 20 février 2010.