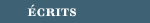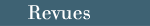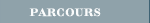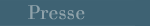Nécessité du roman
mars 2012
La Revue de Belles-Lettres
Un roman est un goût pour faire une histoire
et trouver un air
comme l’air que joue le fifre de Hamelin.
Un air qui captive. Comme si on écrivait une histoire cohérente une fois pour toutes,
qui fasse jeter par dessus bord toute autre version de nos vies.
Du moins le temps de la lecture.
J’aime les histoires qui posent des questions sur notre identité.
Toutes sortes d’identités, comme celle que donne l’Histoire, celle que donne le désir, ou la peur - bien sûr qu’on change d’identité quand on a peur !
Et moi, l’auteur, qui écris, j’aime que le ton du livre tienne quelque chose en suspens. Par le rythme des phrases. Les syncopes. La rupture de la construction.
Rien que je déteste plus que les livres où j’entends un « je sais ». J’aime les livres qui disent ce qui les hante.
Et s’il y en a un qui dit ce qui le hante, c’est bien le livre de Frédéric Pajak, L’Immense Solitude, ce récit écrit et dessiné qui fut élu par le jury Dentan en 2000.
Un livre qui dit l’importance des images pour écrire, pour fantasmer l’histoire.
Et un livre qui révèle que les mots ne disent pas tout.
Il y a toujours quelque chose qui reste derrière les mots, ou après que les mots sont écrits. Quoi qu’on pense avoir développé.
Quand je lis ce livre, je retrouve l’étrange état dans lequel je suis quand j’écris un roman, cet état de disponibilité où je circule entre la lumière de quelques images précises et l’obscurité des grands fonds où j’attends, guette ce qui vient, ce que j’écoute, ce que des mots apprivoisent, ce que j’esquisse comme syntaxe pour faire rendre à ces mots sens et sons.
J’écris et j’ai l’impression de circuler entre la résistance de mes images intérieures, que les mots tentent d’éloigner, et la résistance des mots eux-mêmes pour entrer dans la phrase. Et l’électricité du texte, du texte à venir, circule peut-être entre ces deux pôles !
Le livre de Pajak donne à voir une grande image presque à chaque page. Le dessin est à la plume, et dans la plume qui dessine, je vois une plume qui écrit.
Le dessin est noir/ blanc, beaucoup plus noir que blanc, et met en valeur l’ombre.
En dessous du dessin, le texte, qui peut être une seule phrase ou deux, avoir un rapport direct avec l’image, ou un rapport éloigné. Liberté de l’approche, proximité des mots qui font sens avec l’image ou au contraire un texte qui prend distance, change le regard sur l’image.
Pajak écrit ou cite un extrait de lecture, le statut de son texte varie. Il commente, il ajoute, ou il parle de toute autre chose, de toute façon il opère à un décalage, ma place de lectrice est changeante. Mon point de vue se déplace, le regard est happé par l’image, puis je vais au texte, retourne à l’image, j’y reste, reviens à lire, et ce mouvement, qui est comme d’adapter des focales différentes pour voir, distinguer « une vision », je l’ai tout de suite aimé.
Il me disait ce moment où l’image est là dans la tête quand j’écris, et qu’en même temps il faut m’éloigner.
Je dois m’éloigner pour écrire. Je dois me dégager de l’image intérieure avec ses détails précis, obstinés, et entrer dans l’autre monde. Le monde du son et du rythme, et le monde du sens.
M’éloigner de ce qui hante et obsède, et chercher des mots, des mots qui feront une langue qui se substituera à ce monde chaotique fait d’images et de scènes dont je ne connais encore ni l’avant ni l’après, ni le fondement ni la raison, qui portent une force intense, lumineuse, mais une force silencieuse, mutique.
Et je cherche les mots pour en dire l’irradieuse densité ! – une densité irradiante parce que l’image se développe dans une histoire, et densité radieuse parce que l’image parle enfin !
Aux images de Pajak, à mon tour de m’ouvrir, puis d’aller à son texte et d’en faire une troisième chose, la lecture du roman de l’immense solitude, « Avec Friedrich Nietzsche et Cesare Pavese, orphelins sous le ciel de Turin », comme précise le sous-titre. Ainsi je lis le récit des histoires sous-jacentes de l’auteur, les histoires qui viennent quand on écrit, ici celles de Nietzsche et de Pavese, et qui font qu’on parle toujours d’autre chose. On parle de ce qui hante, se développe et fait la trame fantasmatique de nos vies.
On parle toujours d’autre chose, comme ce que raconte le début de son livre, le récit qu’il fait en trois pages de l’accident mortel de son père. Incipit fracassant. Et j’aime l’écriture lapidaire et frontale d’un début de roman, elle fait un seuil pour entrer dans la lecture. Elle donne aussi la tonalité. Ici celle d’un fracas intime, auquel répondront plus loin le fracas de Nietzsche le jour où la folie fait brèche et le fracas de Pavese qui se suicide dans un hôtel de Turin.
Le livre s’ouvre sur une perte, la perte du père comme la perte du fil qui noue à la vie.
Le texte écrit en bas ou à côté du dessin m’apparaît comme le ruban de la langue pour renouer le fil. Renouer le fil perdu de la vie. Ce qui fait la nécessité du roman.
Tous ses personnages, étrangement tous les personnages qu’il dessine, portent un nez immense. Quelque chose qu’il dit et redit, à chaque page. Comme le nez de Pinocchio, ce nez qui s’allonge démesurément quand il ment. Signe qu’il ment. Signe au milieu de la figure.
J’y ai vu la nécessité de mentir pour qui raconte.
Quand j’écris, j’exagère. Même dans la plus grande retenue de mots que j’adopte et que je désire. J’exagère puisque les quelques détails dont je me sers pour écrire une scène, faire vivre un personnage, sont exagérés simplement d’être élus. Et que j’en exagère le rendu sinon je ne me détacherais pas de la réalité, je n’écrirais pas.
L’écriture est cet effort désespéré, indispensable, je pourrais dire continuel, pour dégager quelques éléments, comme à les sauver de la réalité tellement plus forte que moi. Réalité où je pourrais me perdre de la regarder, de chercher à la voir.
L’écriture est une fuite, une fuite pour se sauver, et pour sauver quelques éléments à dire. Ecrire une suite pour ne pas se perdre dans la fascination d’un monde qui est là, tel qu’il est, dans sa force inégalable.
Le mensonge fait tenir ensemble les éléments qui suffisent à constituer une histoire ; je les ai grossis, leur ai rajouté une intensité distincte. Pour que le lecteur les tienne, se laisse inspirer par eux. Le mensonge commence là. Seulement, il doit avoir des accents justes pour se laisser partager.
Ces accents, je les trouve dans la résonnance émotionnelle des mots.
La palette est large !
Frédéric Pajak invente une forme dont l’originalité puise à la source même de l’écriture, je lui en ai une infinie gratitude, comme à l’égard de quelqu’un qui rend visible un trésor immatériel. Son livre me fait l’effet d’un révélateur. Il rend visible le processus latent de l’écriture, tout en gardant l’ombre, l’ombre féconde, celle du fonds mystérieux des images, des associations, celle aussi d’où émergent le ton et le rythme d’un livre.
Ghislaine Dunant
Post-scriptum : J’ai écrit ce texte bien sûr à partir de l’édition originale, dans ma bibliothèque depuis sa parution (Presses Universitaires de France, 1999). Tout récemment une nouvelle édition est parue, que Frédéric Pajak a amplement revue, modifiée et augmentée (Noir sur Blanc, 2011).