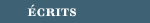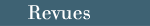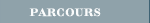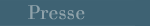Comment j'écris
juin 2006
Midi n°23
« C’est à la fin du dévonien, entre 385 et 365 millions d’années, que s’est produite une révolution tranquille de la vie. Pendant cette période, des poissons osseux ont transformé leurs nageoires en membres pour pouvoir sortir de l’eau et se déplacer sur la terre ferme. »
« Ce prêtre français de 50 ans s’est donné une mission hors du commun : faire parler les derniers témoins des villages d’Ukraine sur l’une des pages les moins connues de la Shoah - la « Shoah par balles », à distinguer de la « Shoah des camps » - et donner une sépulture décente au million et demi de juifs fusillés dans ce pays par les Einzatzgruppen nazis et jetés dans des fosses communes. »
Je découpe tous les jours dans le journal des articles, un entrefilet, un reportage, une phrase.
Je découpe, je mets de côté, je pose sur une pile qui monte. Sans classement. Un temps j’ai classé, j’ai dû varier, augmenter les titres des dossiers que je faisais, ils n’étaient jamais appropriés parce que le sujet de l’article débordait, « Lieux » « Géographie » « Histoire » « Animaux » « Biographies ». De toute façon ce classement, cette disposition en « sujets » n’avait aucune raison puisque j’ai compris peu à peu que de tous ces articles découpés je n’en ferai rien de manière directe.
Il fallait juste que par ce geste d’extraire avec les ciseaux un texte qui m’informait je singularise cette information, je l’élise à mon panthéon des faits. Ils suivent l’aléa de ma lecture d’un quotidien, parfois d’un deuxième.
J’écoute la radio, je ne note pas ce que j’entends à la radio. Je découpe ce que je lis parce que ce sont des mots écrits, des phrases. Je veux qu’ils restent en pile sur un meuble de ma chambre. Je ne les relis presque jamais sinon pour vérifier le souvenir que j’en garde, un détail auquel je pense, je veux juste être sûre de ne pas faire erreur.
Ils sont posés découpés, installés là. Les plus anciens tout en bas de la pile ont jauni, le papier n’est plus agréable à toucher, ils finissent par sentir la poussière. Mais de les avoir arrêtés dans leur trajet vers la poubelle, et entassés, m’oblige. Ils m’ont donné quelque chose, ils m’ont fait réagir, ils résonnent à mes préoccupations.
Après, il faut que j’écrive. Et ça n’a rien à voir avec ce qui est écrit dans ces papiers. Mais c’est comme si j’avais construit une porte en les découpant. Une porte et un seuil et un chambranle. Il me reste à ouvrir la porte. C’est-à-dire à écrire, sortir de la réception de toutes ces phrases qui m’intéressent, qui racontent le monde et l’histoire. Tenter d’écrire ce que je vis. Rendre compte de mon expérience, écrire, faire que mon expérience humaine se transforme en événement. Que quelques détails choisis soient les signes électifs de l’événement. Les points d’appui pour que l’imaginaire qui rôde entre les mots et les lignes prenne figure.
Personnellement je bataille avec le sentiment de n’être pas capable d’écrire. Je ne sais pas « écrire ». Je ne sais pas aligner deux phrases qui vont donner sens. A l’instant où j’écris, ça se dérobe. De quoi je parle, au moment où j’écris, ça perd du sens et moi de même je m’effondre. Alors j’y vais, avec une phrase, une drôle de phrase, il y aura trois mots, ou un, ou deux seulement qui disent quelque chose, rendent compte de quelque chose. J’essaye une autre phrase. C’est bancal, mais il y a quelque chose en dessous qui pointe, je le sens, il faut que je continue. C’est un processus d’arrachement. Je pioche, j’arrache quelque chose à la langue. Je pose, je regarde, j’écoute, j’attends. Drôle d’ouvrier, je me sens. Drôle de travail.
La langue française est d’une incroyable clarté. D’une glaçante clarté. Elle fixe par sa syntaxe les liens entre les mots, elle désigne leurs relations, ce qui détermine l’ordre qui se trouve entre les pensées, entre les actes. La langue française assigne des fonctions à ce qu’elle nomme, c’est la langue que je connais (un peu), avec laquelle j’écris, c’est donc difficile de la plier à ce que je cherche, qui a à voir avec des émotions troubles (souvent), des peurs éphémères ou stupéfiantes, des sensations, le corps n’a pas selon moi une géographie objective qui permette de nommer des relations.
Le corps offre une archéologie subjective, les temps et les époques se superposent, les âges, les personnes, les lieux se chevauchent, la mémoire et les sens troublent l’histoire, mettent en doute la capacité du récit à raconter, à raconter quoi, c’est si confus, si riche, ça se mêle, ça s’entremêle, ça glisse, ça échappe. Alors je coupe mes phrases, j’isole un mot, je fais des phrases courtes souvent juste pour m’en sortir, délimiter ce que j’ai écrit. Que le mot se fasse entendre, dans son oreille intime que le lecteur l’entende et lui laisse une place. Après le point, après l’arrêt dans le rythme, ça reprend, un autre mot, deux, trois alliés pour dire s’il y a une action ou juste que cela est.
J’avance avec des choses petites pour entendre ce que j’ai trouvé, souvent je l’ai juste juxtaposé parce que, de logique, de rationnel, d’établi dans le temps, de ces liens je ne suis pas sûre. Et je préfère que ce soit le lecteur qui établisse les relations. Relations intimes.
J’aime les livres qui ne racontent rien. Mais qui disent. Ils disent l’intense de la vie ou son absence, l’échange ou le manque. Ils disent des états de conscience. Ils disent la présence du réel en ce qu’il force le regard. La puissance du réel en ce qu’il ouvre l’amour ou force à la colère. Leur lecture me met dans un état qui n’a rien à voir avec le reste de la vie parce qu’ils me donnent l’intense du sentiment de vivre que tout dans nos journées recouvre.
Ces deux phrases, lus je ne sais plus où, que j’aime par dessus beaucoup de choses.
« Où une vie commence-t-elle ?
Elle commence n’importe où, n’importe quand. »
J’écris une phrase, je tente de l’écrire, je commence une vie là , à l’instant même de chercher les mots, l’agencement, ce qui est dit.
Dans l’écriture il y a une joie de survivre.