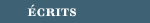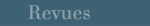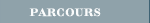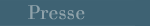Ceux du terrain
1997, Texte avec des photos de Marc Pataut, suivi d'un texte critique de Jean-François Chevrier
Ne Pas Plier,
52 pages
( Texte et photos intégralement reproduits)
Jeudi, le 19 janvier 1995, le long du canal Saint-Denis, un ciel plombé d’hiver. Marc me montre l’écluse, cinquante mètres plus bas. C’est là qu’ils allaient chercher l’eau. C’était le passé, quand ils vivaient sur le terrain, enfin ceux dont on va parler, Noël, Stéphane, Joël, Guy, Eliane, leurs deux filles Natacha et Séléna, il y avait aussi, que je n’ai pas connu, Slavek qui est reparti à Prague, Alain qui avait sa cabane à côté de Joël, Germain et sa fille qui se barricadaient à l’écart des autres.
Les uns après les autres sont venus s’installer là, un jour. Certains y vivront sept ans, cinq ans, quatre ans, Noël lui ce sera treize ans, d’autres quelques mois.

Pour presque tous ce ne fut donc pas un accident de parcours, ce fut une installation. Une décision prise. La construction de cabanes, l’organisation pour vivre, seul, avec d’autres, une vie à soi digne, quotidienne, à travers les saisons sur un terrain qui tenait par endroits de la prairie, aux portes de Paris, en contrebas de la A 1 et de la A 86. Aujourd’hui il n’y a plus que Noël sur le terrain. C’est Stéphane relogé dans une cabane en préfabriqué à Saint-Denis qui lui fait quelques courses et lui cherche l’eau, là-bas à l’écluse.
Le terrain a été retenu pour la construction du Grand Stade, en vue de la coupe du monde de football en 1998. Les expulsions sont méthodiques. Dans quelques mois démarre le chantier.
L’entrée : une trouée dans le mur en béton, à côté des sacs en plastique pleins de gravats, des détritus. Il faut presque tous les jours déblayer pour faire place au sentier. La terre est molle, boueuse, des herbes folles, des arbustes, plus loin l’escalier qui monte sur le terrain, des marches édentées en gravier aggloméré. La majeure partie du terrain est un terre-plein surélevé d’un mètre, on y accède en contrebas par la brèche dans le mur d’enceinte. Guy et Eliane avaient fini par s’installer en bas, près du mur pour se protéger du soleil l’été, des gamins de la cité des Francs Moisins qui venaient chaparder les cerises sauvages. C’était aussi une place stratégique : devant leur cabane ils voyaient tous ceux qui venaient visiter le terrain, Guy ne laissait pas passer les journalistes sans leur montrer comment ils vivaient là.
Des palissades courent ça et là, par endroits renversées, on dirait des lames coupantes.

Elles ont été dressées quand l’EDF a détruit son bâtiment et ses cuves au nord du terrain. Au fil des ans les palissades avancent, mangent de la surface. Le terrain s’est rétréci en face de ces dents menaçantes. Des gravats, des fers à bétons tordus s’amoncellent, attendent comme des questions sans réponse. Au-dessus passent les nuages et l’humidité s’accroche. L’espace me paraît immense, un plateau battu par le vent froid. Nous marchons Marc et moi sur le terrain désolé, d’où la vie s’en est allée, où tout est en attente. Suspendu. Le calme, avant l’arrivée des machines, avant l’excavation, avant que ne commence le chantier, on pense « avant la destruction totale » du sol, de la vie sociale qui existait là, de la nature qui avait poussé. Les semences voyageuses ont fait lever du houblon, des cerisiers, des bouleaux, un pin. Les planches et les tôles qui faisaient les cabanes jonchent le sol, on croit au passage d’un cyclone.
Seul Noël résiste, il vit là, dans sa tente, en bordure du terrain comme dans la limite extrême, délogé déjà plusieurs fois.
Les forages qui sondent le sol à plusieurs endroits ont commencé. Depuis un an le terrain est contaminé, il faut partir, ont-ils dit à Noël. Mais contaminé, le terrain l’était déjà toutes ces années, personne n’est venu nous prévenir, a répondu Noël. A tous on leur a demandé de se déplacer. De quitter le centre du terrain. De se rapprocher du mur d’enceinte. Les bulldozers sont venus, les cabanes ont été cassées.
De la vie vécue là, du bonheur qui a existé malgré les conditions et dont chacun parle, il reste leurs souvenirs, et les photos de Marc.
Noël n’a pas voulu reconstruire, il a planté la tente qu’on lui a donnée l’été 94 et cet hiver il l’a bâchée de plastique contre le froid, le vent glacial.

Il attend, il est en attente depuis dix mois d’un logement annoncé. Il s’est aperçu que c’était le gage d’un contrat-piège. Un logement au sein d’un foyer, sans indépendance, sans autonomie, sans liberté. Noël s’est toujours assumé seul, et le revendique.
Comme tous ceux qui vivaient sur le terrain. Ne se fiant qu’à leurs forces, leur ingénuité, leur malice, leur endurance, pour s’accorder avec leur goût de la vie. C’était vrai l’été surtout, avec la vie dehors, les repas devant les cabanes, les parties de pétanque. Il y a quinze ans, Noël s’est trouvé du jour au lendemain sans logement à la sortie de deux mois de préventive pour une bagarre qui avait mal tourné et deux policiers frappés. Sa femme avec sa fille partie, sans laisser d’adresse, l’appartement rendu.
Je n’ai pas voulu me réinsérer, j’ai préféré me débrouiller. Trouver où dormir, et les moyens pour subsister. J’ai trouvé à La Villette, dans les nouveaux abattoirs restés vides. Je dormais là. J’ai vite vu que les tuyaux, les fils électriques avaient été ramassés. Mais un jour, en me réveillant, je vois au plafond des kilomètres de câbles. Ils avaient été oubliés. J’avais de quoi vivre pendant des semaines. Il m’a fallu trouver une torche, une très grande échelle. Je les décrochais, les brûlais, vendais le cuivre au poids. Ce plafond était une mine. J’en ai sorti trois tonnes. J’avais la mine au-dessus de la tête. En une journée de travail, j’avais le budget de ma semaine. Noël rit quand il nous raconte ça. Il en sourit. L’astuce, la débrouille, le gain – il sent encore le plaisir qu’il en avait.

J’ai été délogé, j’ai retrouvé un endroit près du canal, puis les bulldozers sont arrivés, ils ont détruit ma cabane. Alors je suis venu sur le terrain. J’étais le premier à m’installer. Je partais le matin à quatre heurs vers Paris avec une charrette pour faire de la récupération. Devant les grands magasins, avant le passage des voitures-poubelles. J’avais tout un circuit jusqu’à la mairie du XVIII ème. Quand je terminais, je passais devant les Puces. Je vendais à ceux que je connaissais. J’étais de retour vers treize heures, je faisais vingt kilomètres à pied comme ça. Aujourd’hui je ne peux plus marcher. Je suis malade. Je ne peux plus rester dehors. Il faut que j’aie un logement, il faut que je me fasse soigner. Noël souffre d’une forte hypertension.
L’assistante sociale dit de lui qu’il ne peut pas vivre dans un studio ou un appartement, il y a trop longtemps qu’il vit dehors. Noël n’en croit rien. Ce qu’il sait c’est qu’il ne peut plus travailler, il ne peut plus marcher, ça ne peut pas durer. Il attend. Sous la tente dans le froid glacial de cet hiver. Il lit, il écoute France Inter, il n’a pas d’électricité, depuis quelques mois il a fini par rester couché tout le jour. Il se lève quand il est prévenu d’une visite.
Sur la table construite en planches asymétriques de bois épais, du pain, deux morceaux de pain, le cendrier en plastique blanc plein de cendres et de capsules de bouteille de bière. Devant la tente une montagne de bouteilles de bière vidées. Une chaise sous l’auvent fait d’une bâche bleue, je me tiens là, la radio marche, Noël est assis sur son fauteuil devant sa table, sa grande chevelure, il fume, le pain a l’air d’attendre, lui il retient là l’essentiel. La lumière du jour lui permet d’être assis là, de parler avec les quatre personnes qui sont passées le voir, plus tard ce sera le tour de la nuit de venir. Il se couchera, attendra demain.

Son corps épaissi par les vêtements. Il paraît ramassé sur lui-même, pour résister, tenir, se contenir. Une grande colère à l’intérieur, mais une colère qui a de la patience.
Noël lit beaucoup, ce qu’il trouve, ce qu’on lui apporte, il aime la science-fiction, mais cet hiver il fait sombre dans la tente et sous l’auvent, froid. Et Noël doit tout économiser. Et puis la lassitude morale, l’usure, ces derniers mois, les conditions. Je le comprendrai plus tard combien Noël était au bout. Mais il avait la force encore de vouloir autre chose, d’attendre.
Stéphane et Joël qui sont aussi venus voir Noël, nous parlent de leurs démarches, de leurs déceptions, de leurs attentes, de cette assistante sociale qu’ils ont fini par avoir tous dans le nez tellement ils ont l’impression d’avoir été dupés, de ne pas être compris dans leurs besoins, dans leurs intentions. Je sens au peu qu’ils disent du passé sur le terrain, ou simplement dans leur façon d’être là et de soutenir Noël, sa patience et son attente, que c’est le passé qui leur manque, la vie entre amis, l’entraide et la compréhension qu’ils connaissaient. Par nécessité, et parce que c’est leur mode de vie, leur rapport à la vie. Quand Stéphane rappelle cette époque sur le terrain, il y a dans sa voix une ferveur qui dit la joie et la liberté qu’il ressentait dans ces moments, définitivement perdus depuis qu’il vit seul dans son préfabriqué posé à un coin de rues. Il est confronté tous les jours à la bagarre possible. Des types agressifs rôdent, l’interpellent, se moquent. On lui volera sa carte d’identité, dont il était si fier puisqu’elle avait porté à la mention du domicile : « Terrain du Cornillon, Saint-Denis ».

C’était la cabane qu’il avait construite, l’aménagement si astucieusement établi autour, qui était reconnu. Avec le coin confortable – à sa façon – des gogues peinards, à l’abri des regards. Il en était fier et amusé, il me montrera la photo, un vrai lieu à soi.
Stéphane n’aime que la vie dehors, il ne peut pas vivre en appartement. Sa femme et ses deux enfants y vivent, lui ne peut pas, de toute façon il s’est fait jeter dehors. Il les rejoint le week-end, puis retourne chez lui. Il a besoin de vivre dehors, et si possible dans la nature, de construire son lieu, l’arranger, le peaufiner, lui donner sa marque. Il a l’énergie solitaire d’un Robinson Crusoé.
L’assistante sociale lui a parlé d’une caravane sur un terrain à la campagne, qu’il pourrait avoir. Il lui faut économiser, il la veut, l’espère, fait des projets, imagine y emmener sa femme et ses enfants les week-ends. Joël et Stéphane sont venus ensemble rendre visite à Noël. Ils se voient tous les jours, orphelins de leur vie sur le terrain. Ils ont été relogés à cent mètres l’un de l’autre, Joël dans un appartement au rez-de-chaussée, mais il ne s’y sent pas bien. L’humidité suinte des murs depuis que l’appartement du dessus a été inondé. Au-dessus encore, ils sont nombreux à vivre là, Joël ne dort pas de la nuit à cause du bruit. Le calme du terrain lui manque, la place autour. L’espace autour de soi, c’était une sorte de respect.
Vendredi 31 mars, nous allons rendre visite à Noël dans son nouveau logement à Bondy. Noël a eu une forte grippe deux semaines auparavant, Marc me dit qu’il a été bien secoué, mais Noël paraît tellement mieux là où il est aujourd’hui. D’avoir un lieu qui le protège lui a redonné un temps à lui.

Même s’il n’a pas de meuble encore. Juste un matelas par terre dans la pièce, une table à la cuisine, deux chaises un tabouret, de quoi nous asseoir, parler autour de la table. Il a une salle d’eau, la possibilité de se laver, de laver son linge.
A le voir aujourd’hui, calme, presque serein, je comprends que les conditions qu’il a connues les derniers mois sur le terrain étaient l’extrême. La cité a des arbres. Devant son balcon, un saule pleureur, de l’herbe, un terrain de jeux pour les jeunes, de l’autre côté, les voitures et au-delà d’un peu de verdure, une école maternelle et primaire. La cité a une échelle humaine.
Noël a très peu d’argent, mais il prendra son temps. Pour s’occuper de sa santé, suivre un traitement pour son hyper tension, se faire faire un appareil pour pallier l’absence de la plupart de ses dents et pouvoir mieux manger. Il a perdu quatorze dents d’un coup après la première année dehors. Il sait qu’il ne pourra plus marcher comme par le passé mais il cherchera un travail à faire chez lui, il pense au bois parce qu’il montait des fenêtres dans le bâtiment. Il songe à faire des cadres ou quelque chose de ce genre.
Deux mois plus tard, nous prenons un repas ensemble chez Noël avec Stéphane et Joël. Il fait beau, on est en juin. La porte fenêtre sur le balcon est grand ouverte, Noël a une deuxième table, d’autres chaises. Nous avons acheté des crevettes, des tomates, des cochonnailles, des fromages. Quand j’entends les oiseaux le matin, je crois que je suis encore sur le terrain, dit Stéphane. Il pense à sa caravane. L’été est là, l’éclosion de la nature l’y ramène tous les jours. Il se rend compte que ce ne sera sans doute pas pour cet été.

Mais il la voit, il l’espère. Après le café, nous sortons faire une partie de pétanque. Ils sont les trois de bons joueurs, d’habiles pointeurs, je me fais battre à plate couture.
Le 16 octobre, nous déjeunons avec Noël dans un café-brasserie à Aulnay. Il a reçu un courrier de Guy et Eliane qui attendent toujours le pavillon promis. L’assistante sociale leur avait dit dans quatre mois vous y serez, ils avaient accepté de quitter le terrain et de partir pour la Nièvre à cause de cette promesse, voilà qu’ils attendent depuis seize mois dans un foyer de transit où ils payent 1800 francs de loyer pour un deux pièces. Nous irons leur rendre visite. Noël a récupéré des meubles, une bibliothèque, un canapé, un dos de lit, il les a bricolés pour les remettre en état, les adapter à son logement. Il se refait un intérieur. Il se porte mieux, ça se voit. Un apaisement.
Après le déjeuner, nous passons chez Stéphane à Saint-Denis, il n’est pas là. Nous le trouverons en allant chez Noël. Ils semblent avoir perdu patience l’un et l’autre. A Stéphane on a volé son vélo. On lui retient chaque mois la moitié de son RMI pour son loyer, il ne voit plus comment il peut économiser pour la caravane, et toute démarche maintenant lui demande de prendre les transports en commun, le ticket est cher, on le fait attendre, son irritation grandit, il avait trouvé du travail, le nettoyage des bureaux du chantier pour le Grand Stade justement. Pendant l’été, le nouveau contremaître n’a pas voulu le garder, a donné le travail à un autre. Sans raison, et en plus à un Arabe, lui reproche Stéphane.

C’est là aussi qu’un jour son vélo a disparu et qu’un autre jour, suggérant à deux SDF de se laver dans les douches des bureaux, il s’est fait faucher son portefeuille avec sa carte d’identité. L’hiver approche, Stéphane n’a pas d’eau, pas d’électricité dans son cabanon en préfabriqué. Depuis peu un copain dort chez lui, un ancien étudiant en architecture aux Beaux-Arts de Rennes, qui était devenu tailleur de pierre, il ne trouve plus de travail depuis deux ans.
Joël a perdu tout espoir aussi, il parle de retourner à Arpajon où il a de la famille. Parle-t-il de sa famille d’accueil puisque c’est la DDAS qui l’a placé ? Joël a toujours été secret sur son passé, alors que Stéphane parle volontiers de son enfance, de sa mère qui le laisse à une tante. Elle lui apprend à lire dans la terreur, le menace de l’enfermer dans la cave, met ses menaces à exécution, lui fait apprendre par cœur sous la contrainte des pages entières de livres. Cependant Stéphane maintient toujours un lien avec sa tante. Il ne peut plus lire un livre par contre.
Joël parle peu et encore moins depuis qu’on lui a fait quitter sa cabane sur le terrain. Aujourd’hui il paraît aux abois. Sur les photos qu’a prises Marc à l’époque du terrain je ne le reconnais pas. Je vois un homme solide, au visage serein. Il a maigri, il paraît épuisé nerveusement. Il n’aime pas cet appartement au rez-de-chaussée sur la rue, il se tient dans la chambre parce que la grande fenêtre donne sur un petit bout de terrain où arrive le soleil. Il va tout lâcher, partir. Noël pense que c’est folie d’abandonner un logement si difficile à obtenir. Ce n’était pas sur le terrain, c’est relogé dans cet appartement, que Joël se sent mal, déraciné, en trop, sans joie, sans réalité.

Il sent une telle violence en lui, il le raconte à Marc, contre le voisin noir et ses amis qui se couchent tard et font du bruit, contre les Arabes qui dans la rue l’agressent, une telle violence en lui, à vouloir les tuer, une violence qui lui fait mal, dit-il.
Noël et Marc ont écrit à Guy et Eliane pour leur annoncer notre visite. Nous partons pour la Nièvre le 9 et 10 novembre. Il s’est passé dix sept mois depuis leur départ du terrain un matin d’août après avoir tout emballé et hissé dans un camion. Quand Noël voit Eliane et Guy devant lui, il est ému. Il doit être trois heures de l’après-midi. Nous sommes partis ce matin de Paris, Marc est passé à sept heures chercher Noël à Bondy, je les attends Porte d’Orléans, nous prenons l’autoroute du sud. Une belle lumière d’automne tout le long du voyage. Noël n’avait pas quitté la région parisienne depuis longtemps. Seize ans. Auparavant il se déplaçait dans toute la France pour travailler sur les chantiers. Jeune, il avait voyagé en Angleterre, en Italie. Eliane et Guy sont heureux de revoir Noël, qu’il soit là, chez eux, avec eux surtout parce que de leurs chez eux ils ne sont pas contents. Ils sont en transit et se sentent en transit, le foyer est triste malgré la gentillesse de certains responsables. Triste à cause de ceux qui l’habitent, de ceux qui sont en long séjour, les A.H., adultes handicapés, qui ne peuvent vivre autonomes. Ils attendent. Au pied des escaliers, dans le hall, devant la cafétéria. Ils guettent le passage de l’événement, et cette attente fait planer une mélancolie poignante dont il est difficile de s’extraire.

Même moi qui suis là pour deux jours à peine je ne peux pas y échapper, et je sens Eliane qui est vive, active, énergique, l’être peut-être d’autant qu’elle veut échapper à cette langueur désespérée. Et puis sa colère la décolle de ce qui l’entoure. Elle enrage intérieurement de s’être laissée prendre aux paroles de l’assistante sociale. Elle aurait préféré passer plus de temps sur le terrain qu’ici à attendre dans ce foyer.
A Saint-Denis, Eliane avait un Contrat-Emploi-Solidarité dans un collège où elle était agent de service. Elle partait avant le réveil de ses filles et rentrait à la fin de la matinée. Elle aimait ses collègues, surtout l’une avec qui elle garde le contact, l’atmosphère du collège, les adolescents. Et puis c’était son travail, un statut autonome par rapport à la vie sur le terrain, elle était la seule à avoir un emploi. En partant pour la Nièvre, elle l’a perdu.
Cet emploi, c’était aussi pour ses deux filles. Eliane s’est toujours battue pour les garder avec ele. Son contrat lui donnait l’assurance d’avoir ses filles avec elle, la garantie qu’on les lui laisse. Le papier officiel qui disait qu’elle pouvait les élever. Et l’assistante sociale n’a pu toujours que constater les bons soins que recevaient les petites. Eliane vient de la DDAS, elle a été placée dans une famille d’accueil de la Nièvre qu’elle considère comme sa famille. Elle n’a connu ni sa mère ni son père.
Après un moment tous assis autour de la table, après les premières retrouvailles, nous partons chez Natacha et Séléna à l’école.
Le seul point positif de notre déménagement, nous dit Eliane, c’est la scolarisation des filles. Les premiers mois d’école ont été difficiles pour Séléna. Sur le terrain, elle ne quittait pas sa mère d’une semelle, et les parties de pétanque, Eliane les jouait souvent, Séléna sur la hanche… Alors l’apprentissage de la séparation avait donné des larmes.

Et le chagrin, la douleur de Séléna avaient noué l’estomac de sa mère. Aujourd’hui elles partent toutes les deux de gaîté de cœur à l’école avec leur goûter dans leur sac. Elles sont heureuses de me montrer avec leur cahier et feutres qu’elles ont chacune à la maison ce qu’elles apprennent à l’école, Séléna, à 4 ans, dans la moyenne section et Natacha, à 5 ans et demi, dans la grande section de la maternelle.
Le trajet est long jusqu’à l’école, parce qu’Eliane a préféré les mettre à l’école privée St Joseph qu’à l’école publique, elle les trouve mieux suivies. Alors sur le chemin chacune dans une main, Eliane chante avec elles, elles font des jeux, récitent des comptines, ça réchauffe, ça raccourcit le trajet.
Imphy est une commune qui vit de son activité industrielle, dans les aciers spéciaux. Excepté les bords de Loire, adoucis par la lumière du fleuve, la ville est triste. Et comme dit Eliane, elle trouve difficile l’esprit des gens, ici. C’est pas Paris, c’est pas la même mentalité. Elle n’en dit pas plus, ses lèvres se pincent, elle secoue la tête négativement, ferme la douleur qu’elle a en elle. Elle sait de toute façon qu’elle ne peut plus partir ailleurs. Elle attend le pavillon de Decize, elle l’a trop attendu pour changer sa décision, ils sont trop près du but. Elle attend leur vie une fois installés, espère reprendre du travail. Elle voudrait être assistante maternelle, nourrice, pour continuer d’être proche de ses propres enfants.
De toute façon, ma formation, qui est d’être opératrice de saisie, je n’ai jamais pu l’exercer. J’ai tout de suite été au chômage.

Et quand j’ai trouvé quelque chose, c’était de faire le ménage dans un hôtel, le lundi seulement, et au noir, car ici c’est si dur économiquement qu’ils ne peuvent pas payer les charges sociales. Mon premier mari, qui était ouvrier, a été au chômage aussi assez vite. Et quand j’ai connu Guy, il avait déjà de telles difficultés, il était au bord de fermer son café. Je l’ai rencontré un dimanche à une fête dans son café, il m’a plu. Quand tout le monde est parti, il y avait un tel désordre, un tel travail pour ranger, je lui ai dit que je viendrai pour l’aider. Mais le lendemain, je ne pouvais pas, c’était lundi, je travaillais à l’hôtel, je suis donc venue le mardi matin. Il ne m’attendait pas, il ne m’avait pas crue quand j’avais dit que je reviendrai. Voilà, ça a commencé comme ça.
Le lendemain, nous irons à Decize. Depuis la rive droite d’où nous arrivons, l’ancienne ville, les remparts, le vieux pont nous charment. Tout à l’heure nous irons nous y balader, pour l’instant Guy et Eliane nous montrent leur pavillon en travaux. Et très vite on voit qu’ils devraient y être bien, et nous comprenons que cette perspective depuis plus d’un an les fait tenir, en même temps qu’elle les met à bout de patience, parce que c’est une autre vie enfin, à portée de main.
De l’autre côté de la maison, un bon bout de jardin. Une grande cabane à outils, qui fait que fusent les moqueries affectueuses, ça y est Guy tu l’as de nouveau ta cabane sur le terrain ! Je compte bien la garder, assure Guy. J’ai déjà commencé à récupérer du matériel. Effectivement il y a déjà à terre, un tas de tuyauterie amoncelée. Guy veut aussi faire quelque chose de son jardin, mais il nous répète je n’y connais rien, il faudra que je m’y mette. On sent l’inquiétude percer. Son ignorance ne le rassure pas.

Mais il y a son voisin, une connaissance de bien des années en arrière, du temps de son café à Porcher, et comme lui un Parisien. Il se sentira épaulé. Car l’amitié compte pour Guy, beaucoup.
C’était la vie sur le terrain. C’est aussi ce qui l’a rendu possible. Et à Imphy, à peine Noël arrivé, il fallait à Guy très vite emmener Noël au café en bas, au bord de la route, à l’entrée d’Imphy, « Chez Michel ». Michel est un ami, il fallait donc qu’il rencontre Noël, c’était le bonheur de Guy, de sentir cette chaleur. Tous les jours de la semaine vers six heures ils descendent « Chez Michel » pour l’apéritif. Eliane va chercher les petites à quatre heures et demie, fait les courses nécessaires, remonte – le foyer est en haut de la colline- et avant de préparer le dîner, ils descendent passer un moment au café. Guy, lui, vient déjà le matin, après son réveil. A six heures il fait l’ouverture et commence la journée en compagnie. Guy le dit lui-même, je suis plutôt un fêtard moi, et puis j’ai toujours été dans la restauration. J’ai commencé à La Compagnie des Wagons-Lits, dans les trains, ensuite dans la société de tourisme, je faisais les saisons dans les hôtels en Grèce, aux Baléares…. Quand j’ai voulu me stabiliser sur Paris, je suis rentré à la Ville comme chauffeur de voiture. Je conduisais les hommes politiques. Ma compagne est tombée malade. Je l’aimais. Sur les cinq ans qu’on a vécu ensemble, elle a fait quatre années à l’hôpital. Des opérations terribles. A sa mort, j’ai un peu disjoncté.
Il y avait les restrictions à la Ville de Paris, on m’a proposé un pactole pour quitter ou de prendre un autre emploi, conduire les camions de ramassage d’ordures. Ça ne m’intéressait pas.

J’ai préféré partir, et reprendre un café dans la Nièvre, à Porcher, mais on ne m’avait pas prévenu qu’il n’y avait que trois mois de saison, l’été c’est tout, sinon rien ou presque dans ce village de 250 habitants. J’ai tout bouffé en deux ans. Je n’arrivais plus à payer les charges sociales, et j’ai rencontré Eliane.
Quand j’ai dû fermer, elle avait la petite dans le ventre. Natacha est née à Decize, prématurée. Il n’y avait pas de centre néo-natal, elle a été transférée à Moulins. Eliane d’ajouter, il n’y avait que Moulins ou Paris, j’ai voulu Moulins, c’était plus près. On nous avait dit un mois et demi, on s’est présentés le jour pile pour la prendre, on est arrivés le soir même à Paris chez ma belle-sœur, et déjà ils téléphonaient pour la reprendre parce qu’on n’avait pas de domicile. Je me suis battue pour qu’elle reste là. Guy et moi on dormait dans notre voiture, on payait un pécule pour que la belle-sœur la garde. J’allais la voir tous les jours. Après on a vécu dans une cave pendant six mois, et puis j’ai attendu Séléna. Ma grossesse était difficile, j’ai eu une place dans une maison de repos au Vésinet. Guy venait tous les jours me voir. C’est encore ma belle-sœur qui a gardé la petite après la naissance. Ils habitaient un des immeubles en brique qui bordent le terrain. Mon beau-frère m’a dit, il y en a qui se sont installés, tu devrais aller voir.
Voilà on s’est installés en 91. C’était dur les conditions, terrible parfois. C’est pas une vie. En même temps on s’y attache. Ce qu’on construit, ce qu’on fait à la force du poignet, c’est nous, quoi…