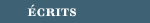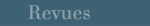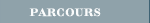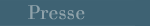La lettre oubliée
1993, roman
Gallimard, collection Blanche
234 pages
( Extrait de la Deuxième partie : "L'été 1905" )
Belinda.
Cette nuit je ne me suis pas couché. La nuit se termine, mon corps ne sent plus ses limites, ni ses forces, ni sa fatigue. Il n’a plus de poids. Mes yeux, je crois qu’ils ne voient plus, c’est mon corps qui voit. Ma main s’accroche à cette plume, et gratte, pour tenir mon corps à la table.
Le jour se lève, le mystère a lieu à nouveau.
Ce n’est pas la même chose, quand il n’y a eu ni le sommeil ni l’oubli des choses qu’amène la nuit.
L’aube me paraît naturelle quand je m’éveille en même temps que le jour. Or si j’ai vécu le fond de la nuit, si j’ai cherché à la prolonger, je ne m’attends pas à la métamorphose du jour qui vient. Je ne la comprends pas. Les choses basculent, je glisse une pente infiniment sans pouvoir saisir de prise. Le ciel s’éclaircit, quelque chose se déchire, la mort arrive, j’imagine qu’arrive la mort.
Il est inutile de crier.
Je gratte cette lettre et m’accroche à cette table, comme je chevauche ton corps. Tenir sur ta peau la vie qui peut me traverser. L’aube que nous avons connue ensemble, je l’ai reçue sur ta peau, je l’ai découverte à la lumière de ton corps. C’était encore au bout de la nuit. La vie traversait.
Je ne sentais pas qu’on me coupait la tête.
Cette nuit à l'auberge, le jour venant, j'ai cru qu'approchait la faux. L'aube peut devenir une guillotine. Le ciel blanchit, le métal tombe. Soudain il n'y a plus d'air.
Une mélancolie, la nuit qui disparaît. J'aurais voulu continuer, retenir ce qui m'échappe. Je ne suis rien. Rien qui reste. J'ai mal au coeur dans l'aube qui arrive. Le coeur qui chavire comme on dit. Comme un changement de perspective, s'enfuient le haut et le bas, la profondeur, l'étirement des dimensions, dans lesquels j'étais entré, auxquels je m'étais habitué.
Martha était assise à côté de moi, en face plutôt. Les coudes appuyés sur la table, ses bras nus montaient comme deux colonnes. Elle a les mains si carrées que j'imagine qu'elle peut étrangler un cheval. Image étrange! Je n'ai jamais vu ni entendu personne étrangler un cheval. Est-ce parce que je viens à l'auberge à cheval ? Est-ce parce que j'ai peur que Martha m'étrangle? Ou que je désire qu'elle | m'étrangle?
Tu sais, elle est toujours de noir vêtue, pour le service bien sûr, mais je finis par la voir comme une veuve. La veuve d'un cheval qu'elle a étranglé. Ou c'est moi qui suis le vieux cheval qui en fin de nuit résiste pour être là encore.
Important que je voie Martha en veuve. Je pense parfois qu'un artiste ne peut ou ne doit croiser que des veuves. Et je ne dis pas cela pour toi seule, non, mais tu es un emblème. La femme pour être complète, je veux dire féconde, doit être allée tout prés de la mort. Etre descendue chez les morts avec le compagnon. Puis être revenue. Elle n'est pas la mort, elle n'est pas la faucheuse, mais elle doit connaître le passage, avoir cheminé sur le pont qui mène aux Morts. La vie, enfanter, ne suffit pas. II faut être allé là-bas, tout près. Est-ce que je me sens protégé ainsi? Peut-être.
Ma Belinda, je t’ai toujours connue veuve. Imagines-tu que j’aie pu rencontrer Madame von Mischkoff accompagnée de son époux ? Ta beauté n’en eut pas été changée, ta valeur à mes yeux, oui. Et tu sais comme l’adultère ne me convient pas. L’air y est confiné, irrespirable. Mes manières de cosaque m'auraient fait cogner partout.
Tu as eu la fonction du passeur. Tu avais accompagné Paul à la mort - ne m’as-tu pas dit que tu ne l’avais pas quitté pendant son agonie jusqu’à ce que la mort ait raison de lui ?
J’ai besoin que tu aies été très près de la mort. La vie se nourrit d’elle, jamais l’inverse. J’ai toujours l’impression d’arracher à la mort ce que je trouve. Je travaille contre elle. La musique vient de la mort. La musique grignote et amplifie ce que l’autre dévore. C'est pourquoi le silence est si essentiel en musique. Pas seulement le silence pour écrire - et c’est vrai que c’est ici que je trouve le plus grand silence et que j’aime le mieux composer - mais le silence avant, après les notes, autour du thème, comme la mer autour des rochers qui affleurent et que l'eau et l’écume frappent inlassablement. La musique, c’est dire et ne pas dire, écouter, faire monter, attendre. Peut-être ce que la femme sent de son plaisir. L’attente, le déferlement, la pause, le retour du désir.
Et toujours faire entendre. Quand je dis faire entendre, c’est pour moi écouter. J’écoute ce que je cherche.
Hier soir je suis allé seller le cheval à l’écurie. La lune était déjà là, haute dans le ciel, elle éclaircissait le pays. Ça fait deux jours que je travaille mal. Entre la langueur et l’énervement. Quelque chose que je n’entends pas, sur lequel je me bloque. Alors j’avais besoin de courir dans la nuit. Le martèlement des sabots d'Olifan m’entre dans la tête, m’assourdit, et me fait du bien. Au pas le balancement de sa croupe me berce. Et la nuit adoucit l’espace. Il y a des musiques diurnes et des musiques nocturnes. Comme pour moi, Belinda, tu es une femme nocturne. L’espace sans fond que tu me donnes. La veuve que tu es. La révélatrice aussi. La nuit dévoile, l’obscurité révèle. Comme la surdité de Beethoven. C’est là qu’il a trouvé la musique.
Je reviens à cette nuit, Belinda, l’écurie tiède, l’odeur âcre, chaude. Seller Olifan. Sa surprise, ce que je pouvais prendre pour son bonheur, sa façon de bouger son poids d’une jambe sur l’autre, d’une épaule sur l’autre comme s’il cherchait à l’écurie déjà la sensation de l’amble. Et ce dialogue supposé avec l’animal, qui fait soudain tant de bien parce que tout paraît simple. Bref j’étais gai tout de suite, la nuit avait renvoyé d’un coup la dureté du jour. La nuit, tout se distend. D’abord moi. Plus de limite, plus de frontière, plus de pesanteur. Pourtant je ne travaille jamais la nuit ! Toujours le matin tôt avant d’avoir rencontré quiconque, sauf Sophie qui m’apporte le déjeuner. La nuit, je suis fou, je crois tout possible.
Mais c’est le matin que je t’écris, Belinda. Quand il faut tout commencer. Et commencer par toi m’aide à ouvrir la journée. Une façon d’ôter le poids qui m’oppresse, l’immobilité qui cherche à me vaincre.
La maison dort et je cherche à te joindre. Pour reprendre pied après la nuit. Cet élan vers toi, c’est enclencher l’élan pour le travail tout à l’heure, l’élan vers ce que je ne connais pas, que j’irai chercher. Alors il me faut de l’aide, toi, sentir la résonance dans ton corps que je cherche en t’écrivant, qui est à la fois couché sur la table où je me penche, caché derrière les mots que j’écris, évanoui dans le blanc du papier, et au bout de mes doigts –ces doigts qui se contractent autour de la plume parce qu’ils ne peuvent te toucher.
Le travail est une forme de l’amour. C’est de l’amour. De l’amour à vivre, de l’amour caché à révéler, de l’amour à chercher, de l’amour à dire, de l’amour à détruire aussi peut-être.
Car c’est une façon d’être sans rien, débarrassé de tout, de tous, à chercher ce qui va vous combler sans savoir ce que c’est. Je me bats avec les instruments, avec les lignes mélodiques, j’ai à les faire naître, le souffle à trouver, j’ai l’impression de partir avec rien, et j’ai peur, c’est vrai, souvent, jusqu’à ce que ça vienne, puis ça recommence, revient la peur. Alors le matin, quelque temps avec toi, j’amadoue le temps, je me prépare à vivre.
Aurais-je pu vivre avec toi? Pourquoi est-ce toujours cette distance, mon éloignement de toi dont je suis si proche qui m’a porté, amené à sortir ce que je peux? Pourquoi a-t-il fallu cette distance pour que je gagne ma liberté, ou que je gagne cette dépendance de toi...? Est-ce dans l’écart que je franchis ce qui ne m'appartient pas? Que je découvre ce que je veux, ce que je peux?
Ni Angelina, mon épouse, ni Adeline, ni Léone, mes filles, ne sont entrées dans cette marge qui est l'espace où je tâtonne. Le lieu de mes doutes, de mes certitudes, de ce que j’ose, de ma solitude. Un espace que tu m'as donné, Belinda, comme si tu avais su immédiatement qu'il fallait que j'aie un lieu où j'essaye, où je tombe, où je me lève pour me reconnaître. Un lieu où j'ai mal sans toi, où je fais du mal aussi. Cet espace loin de toi c'est mon réservoir. Je plonge, j’émerge.
Plus j'écris, plus je guéris. Là, à t'écrire j'oublie le jour, j’oublie aussi cette nuit. L'ivresse, le froid sur le visage quand je chevauchais Olifan. Séverine était à l'auberge, elle ne voulait pas de moi. Tu connais la morgue des femmes quand elles n'ont pas besoin de toi... Elle en jouissait. D’autres sont venus, j'en avais la rage au coeur. Je ne faisais plus qu’écouter racler les pieds des chaises, taper les tables bancales, les bancs frapper le mur quand l’un s’asseyait.
II y a un peu de monde par ces nuits d'été, et même tard sur la terrasse de bois. Plus l'heure avance, plus lourd et lent se fait chacun. Markus a l'air de ne plus rien entendre, il faut crier ce qu'on veut boire. Aloïse va se coucher, elle ouvre tôt le matin - une fois qu'elle est partie, il y a quelque chose de plus dur qui s'installe. La nuit qui ne finit pas ou plutôt chacun qui est là ne veut pas en finir avec sa nuit. Il faut en découdre encore, et Alolïse partie, il y a quelque chose en face qui a fui.
Pourquoi, soudain la nuit, ai-je envie que tout le monde soit là? Je veux réactiver tous les rapports que je peux entretenir comme s'il fallait dire, faire ce que le jour n'a pas permis, ne peut permettre, et d'une autre manière, d'une autre façon vivre fort ou follement, d'une façon débridée, des liens, des paroles, des actes qu'on ne sait pas dire ni faire, le jour, d'habitude. Par habitude. L'habit du jour voile ce qu'il faudrait savoir voir. Et faire.
Alors il y a une revanche. Et la nuit donne des envies de faire et de détruire. Et quelle étrange chose, quel étrange spectacle qu'une salle d'auberge, les hommes attablés, le bruit, la fumée, l'obscurité dehors, les lampes qui éclaboussent les visages, opacifient la fumée, le mélange de silence et de bruits, les cris, les vociférations, les chants! II y a dans ces mélanges l'expression de la douleur. Comme si la cacophonie faisait entendre les disjonctions, les crevasses qui fissurent les liens qui pourraient unir les hommes.
Puis il y a les longs moments de silence - puis, où? comment? pourquoi? surgit un bruit, une parole, un chant. Et paraissent alors les gestes, les corps comme la face cachée des sons, leur part souterraine, sourde. A passer ma soirée là, ou ma nuit, je me laisse porter, emporter, envelopper par tout ce qui se trame là, comme si c'était dans cette immersion que je trouverais la solution. Le souffle.
Extrait de la page 108 à 113, "La lettre oubliée", Ghislaine Dunant, copyright Editions Gallimard
"Tous les droits d'auteur des oeuvres reproduites sur ce site sont réservés. Sauf autorisation, toute utilisation des oeuvres autre que la consultation individuelle et privée est interdite".