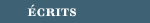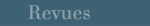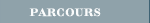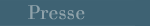Un effondrement
septembre 2007
Grasset, collection littéraire de Martine Saada
133 pages
Ce livre est né d’une phrase qui m’a atteinte de plein fouet.
« J’ai honte de faire une dépression », me dit une amie dans le jardin de l’hôpital Sainte-Anne.
Je ne sais pas ce que j’ai répondu. Je ne me souviens que de sa phrase.
Elle traversait une épreuve douloureuse et en plus elle avait honte ! J’étais en colère, j’étais impuissante.
Et je me suis rappelé, elle savait que j’avais fait une dépression, il y a longtemps. C’était donc une honte aussi à ses yeux ?
Je lui rendais visite, on s’asseyait dans une petite salle ou bien dehors, je regardais les malades, les infirmières, leurs relations. Rien de ce que je voyais ne ressemblait à ce que j’avais traversé pendant ma dépression. J’en avais gardé bien autre chose.
Le livre que je voulais écrire cet été-là, pour lequel j’avais accumulé des pages de notes et réussi à trouver une petite maison pour y travailler, j’ai compris que je ne l’écrirai pas maintenant. J’ai posé au bout de la table mes chemises pleines de pages, et juchée sur cette étrange chaise haute que j’avais trouvée au rez-de-chaussée, j’ai commencé à écrire la scène de « Million Dollar Baby » où la boxeuse s’effondre.
Je voulais cette scène, sa violence, ce coup qui terrasse, anéantit une vie.
La scène m’avait bouleversée. Le coup faisait d’elle un légume, et je m’étais vue.
Le film à cet instant coupait le souffle, en même temps que l’émotion attendrissait, menait à un autre registre, ouvrait sur autre chose, une autre voix. Et je voulais écrire ce livre avec une voix douce.
Raconter l’effondrement comme un tremblement de terre sans bruit.
Mettre en scène la traversée des jours où j’avais tout perdu sans bien comprendre.
Je construirai le récit sans écrire le mot dépression, je ne chercherai pas à exposer la maladie ou ses raisons. Je resterai loin de l’autobiographie, ce qu’on apprend de la vie de la narratrice prend peu de place. Ce sont les journées qu’elle vit que j’ai cherché à écrire. Les lieux, ce qu’elle y trouve, ce qu’elle sent d’elle et des autres. Les situations où elle touche ce vide qui la cerne jusqu’à l’insupportable. La vie qu’elle guette, qu’elle attend, qu’elle ne sait pas comment attraper mais dont elle attend tout le temps un signe.
Et je ferai le portrait de ceux qui sont là avec elle, qui vont prendre de plus en plus d’importance, qu’elle scrute, qui la désespèrent, qu’elle ne comprend pas ou qu’elle se met à rechercher parce que, auprès d’eux, soudain c’est l’ouverture.
J’ai voulu écrire mon effondrement sans pathos, sans aucune plainte surtout, parce que l’état de dénuement m’a paru riche. Et je découvrais que c’était la réponse à la honte. J’ai cherché à dire et faire vivre ce dénuement avec des mots et des phrases qui tâtonnent ou qui suivent le singulier trajet que fait la peur dans la tête, ou la stupeur.
Ma mémoire m’a servi à construire les scènes, je me suis émerveillée de la netteté des images après plus de trente ans, elles étaient si fortes qu’elles se détachaient. Elles ne comptaient plus pour moi mais pour ce qu’elles racontaient.
Ce qui se dessinait derrière le livre que j’écrivais, c’était, comme c’est difficile d’être un être humain, une personne. C’était devenu le titre, la phrase qui me guidait, comme c’est difficile d’être un être humain.
Ce que vit la narratrice pendant ces mois de relégation, c’est la mise à nu de ce qu’elle est ou n’arrive plus à être. Une question. L’incertitude de vivre.
Ghislaine Dunant


Ein Zusammenbruch
mars 2011
Traduction allemande de Claudia Steinitz, Rotpunktverlag