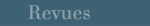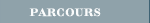Quand ça craque au milieu de la vie, par Eric de Bellefroid
31 août 2007
La Libre Belgique,
Jours blancs d'une pâle fatigue
Comment s'éteignent soudain les lumières de la vie, sous un brouillard d'épaisse fatigue, quand tout devient montagne. Plus d'envie, plus de désir, partant plus de joie. Un récit plein de tact et de délicatesse de l'écrivaine Ghislaine Dunant, née en 1950.
Ce jour-là, les images se brouillent et se confondent. La mémoire se voile, les idées s'emmêlent, la parole s'estompe, le sommeil se dérobe. Le monde est trouble, demain est de plus en plus incertain. Quelque chose a craqué, la machine a coulé une bielle. La vie, comme le cristal, s'est fendue en silence.
On a perdu toute envie, toute estime de soi, et s'il nous reste une volonté, c'est celle d'ignorer qu'on est malade. Il nous reste la force d'un déni obstiné, parce que si la maladie est reconnue cliniquement, elle demeure socialement mal admise, presque honteuse encore. Une telle faiblesse, une telle fatigue de soi, comme disait le sociologue Alain Ehrenberg, dans une société vouée tout entière à la performance.
Là est toute la tragédie de cette fêlure intime, en ce qu'elle est inexplicable et incomprise, et fatalement vécue comme un huis clos. L'écrivaine Ghislaine Dunant ("L'impudeur", "La lettre oubliée", Cènes"), avec un talent avéré, a cependant essayé de poser des mots sur cette douleur de vivre. Dans "Un effondrement", elle évoque une expérience personnelle qui remonte à... 1973. Il fallait oser aller chercher si loin le souvenir de symptômes et d'affects déjà si difficiles à décrire au présent, ou même dans un proche passé.
Elle raconte comment, sortie trop tôt de la clinique pour être emmenée au bord de la mer en famille, elle aspirait à l'océan comme on attend un miracle. "L'océan me referait. Je deviendrais comme avant. Je serais à nouveau vivante. Il fallait que j'aille à sa rencontre mais je n'avais pas la force de marcher jusque là-bas. Je devais aller le rejoindre, je ne pouvais pas."
L'évidence nous vient alors qu'il n'est rien de plus sûr que les murs taciturnes de l'hôpital. Un lieu, désormais, où l'on ne nous demande rien, où l'on n'attend rien de nous, rien de soi. Que de tâcher de vivre, une minute après l'autre. Tenter d'attraper quelque chose, comme elle dit, debout dans le couloir ou en marchand dans le parc. Ce sont alors d'interminables journées blanches.
"C'était difficile d'échanger quelques mots avec les autres. (...) Et ce qui nous préoccupait, nous le taisions. La raison d'être arrivé là, la raison qu'on ne trouvait pas vraiment. Parce que s'il y avait des raisons de mal vivre, un surmenage, un deuil, une douleur morale, aucune n'expliquerait pour autant d'être ici."
Et le moins pénible, le moins étrange n' est pas l'improbable dialogue avec les médecins ou les psychologues. Car comme s'ils voulaient avoir une emprise sur leur patient, ils ne peuvent sans doute supporter leur propre impuissance face à l' informulable. Reste donc à s'en remettre aux médicaments, aux piqûres, aux perfusions. Dans la crainte éventuelle des électrochocs.
On boira l'humiliation jusqu'à la lie, ce sentiment d'être parfaitement décérébré et dépersonnalisé, quand on ne sait pourquoi, un jour lointain, des semaines ou des mois plus tard, la pente se met à remonter. On s'attache aux quelques mots d'un compagnon de souffrance, à un bouquet d'arbres au milieu du parc, à une brise caressante sur l'herbe tendre. Brille alors comme le temps du regain inespéré.
Comment s'éteignent soudain les lumières de la vie, sous un brouillard d'épaisse fatigue, quand tout devient montagne. Plus d'envie, plus de désir, partant plus de joie. Un récit plein de tact et de délicatesse de l'écrivaine Ghislaine Dunant, née en 1950.
Eric de Bellefroid
La Libre Belgique, vendredi 31 août