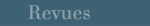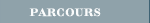La voix nue, par Emily Barnett
18 septembre 2007
Les Inrockuptibles,
Ghislaine Dunant décrit l'errance d'une jeune femme dans les couloirs d'une clinique psychiatrique. Un récit d'une douceur bouleversante sur la difficulté de vivre.
Un effondrement - et voici le récit à venir placé sous le signe de l'indéfini, de l'impersonnel. Rien, par la suite, ne viendra démentir cette neutralité. De la narratrice, de ce court récit, on ne saura presque rien, sinon qu'elle vit à Paris, travaille dans un bureau, voit une soeur. Quant au mal qui, du jour au lendemain, s'empare de sa tête, ruine son quotidien, pulvérise ses nuits, au point d'être forcée de quitter sa vie pour ne plus rêver qu'à sa possibilité dans une clinique psychiatrique, il n'est jamais nommé. On sait seulement qu'il dessèche la bouche et brûle le corps dans les moments de peur, ankylose à force de vide et de silence.
Comment raconter une maladie qui n'a pas de nom? Et qui plus est, est une maladie psychique? C'est par cette question que le quatrième texte de Ghislaine Dunant est travaillé de bout en bout, à elle aussi qu'il doit sa forme. Ainsi, la pauvreté en données objectives n'est pas sans vocation: il n'y a pas d'arrière- plan historique ou identitaire possible, parce qu'il n'y a pas de causes du mal. La narratrice n'a connu aucun malheur: " Ce qui m'avait arrêtée, je ne le savais même pas. Je ne savais pas pourquoi l'angoisse m'avais submergée. On était ici parce qu'on était lié à quelque chose d'obscur dans la réalité". Reste une voix- la sienne- esseulée, fragile, seule dépositaire de la maladie, dont elle restitue les affres avec une grande douceur.
Douceur dans la construction du récit, d'abord, quand elle choisit pour ses premières pages de substituer à sa propre chute celle, bien connue, d\'une héroïne de cinéma, comme pour en éluder la violence. Douceur encore dans le portrait, pourtant peu reluisant, qu'elle brosse du milieu clinique. A la différence des films-réquisitoires des années 70, assez hauts en couleur, contre l'univers psychiatrique (Vol au-dessus d'un nid de coucou, l'Epouvantail), l'auteur instille ici avec une tristesse résignée les raisons d'une déshumanisation progressive: le paternalisme des médecins, l'indifférence des infirmières, mais surtout l'inexistence du lien social entre les patients. Les chambres, les couloirs font figures d'espaces inhabités où circulent des fantômes.
Douceur enfin de la voix, dans sa matière sensible, son tissu impressionniste. Les observations sont fines, précises, les mots sont simples. Comme si la narratrice cherchait à ramasser la complexité du monde dans une langue élémentaire, presque enfantine, pour mieux l'apprivoiser. A plusieurs reprises, elle rapproche son état de celui d'un nouveau-né: "Le moment où combattent la vie et les forces hostiles, le froid et l'air, au sortir de la protection utérine. Il faut naître. Il faut vivre. Il faut affronter l'incertitude de vivre". Bref, il faut être dingue.
La maladie jamais nommée prend peu à peu la forme d'un état de conscience accru, une lucidité de regard sur notre condition d' humain. Et c'est, tout d'un coup, la vie à l'extérieur de la clinique qui prend un aspect irréel. Le désir de vivre sera incarné par un geste, à la fois fascinant et dérisoire: vouloir arroser les plantes de son appartement, mais surtout trouver la force de le faire.
Emily Barnett
Les Inrockuptibles, 18 septembre 2007